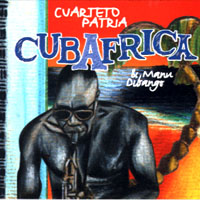Salsa

De Paris à Tokyo, la salsa opère un retour en flèche sur la planète. En Afrique, un continent qu'elle séduisit dans les années 20 et dont elle transforma le paysage musical, elle envahit les boîtes de nuit et connaît un regain de popularité chez les musiciens. Explication.
Le grand retour
De Paris à Tokyo, la salsa opère un retour en flèche sur la planète. En Afrique, un continent qu'elle séduisit dans les années 20 et dont elle transforma le paysage musical, elle envahit les boîtes de nuit et connaît un regain de popularité chez les musiciens. Explication.
Le groupe sénégalo-béninois Africando vient de s'offrir la collaboration du Cubano-portoricain Ronnie Baro. Les Ivoiriens Monique Seka et Tintino en font la nouvelle couleur de leur musique, tandis que le groupe réunionnais Tropicadero la mêle au jazz sur fond de textes créoles polémiques. En Afrique centrale, la salsa retrouve ses lettres de noblesse : Papa Wemba a invité sur son dernier album (Nouvelle écriture) le prestigieux Tito Puente, Tshala Muana a enregistré à New York le CD Mutuashi avec le gratin des salseros de Spanish Harlem. Quant à Manu Dibango, il l'explore dans sa prochaine création (à venir). Bref, la salsa, longtemps considérée comme une "musique à papa", trouve un regain de faveur chez la jeune génération. Un engouement qui s'explique en partie par les profondes racines africaines d'un genre qui n'a cessé de circuler entre les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique : au dernier festival d'Angoulême, l'Orchestra Aragon reprenait notamment le titre "Yaye Boy" d'Africando, confirmant la reconnaissance par les salseros de l'africanité de leur musique.
Mais la folie "salsa" atteint aussi le Japon, qui produit depuis quelques années ses propres groupes de salseros, et l'Europe. Compay Segundo a ainsi été "redécouvert" à l'occasion des rencontres Flamenco y Son organisées à Séville en 1991. En France, la salsa retrouve la saveur des boîtes de la Côte d'Azur depuis deux étés et certaines stations balnéaires comme Trouville ont même mobilisé patrons de casinos et commerçants pour financer la venue de salseros chargés d'animer les rues de la ville pendant l'été 1997. A la suite de Bernard Lavilliers, séduit depuis vingt ans par les sons latins, des artistes français trouvent là une nouvelle recette de succès : Danny Brillant a vendu 300.000 exemplaires de son album Habana et Lio s'est installée pour six mois à Cuba afin d'y préparer son nouveau CD. Aux Etats-Unis, terre de résidence de nombreux latinos, les ventes de salsa ont augmenté de 27 % dans les six premiers mois de 1997 (par rapport aux ventes de 1996). Ce qui suscite l'intérêt des artistes américains, notamment Steve Coleman et Ry Cooder, qui, à l'occasion de son album Bueno Social Club a invité quelques figures légendaires comme Ruben Gonzales, Eliades Ochoa et Compay Segundo.
Sons passés à la moulinette
"Avec cet enregistrement, je viens de terminer la plus grande expérience de ma vie, la plus grande que j'ai jamais eue ou espérée". Cette réflexion de Ry Cooder à l'issue de sa "communion latine" illustre bien la bouffée d'air frais et le retour à une musique conviviale que recherchait un public gavé de sons passés à la moulinette des boîtes à rythme comme la danse et la house. "C'est une musique qui a du sentiment et qui est créative. Elle réunit les jeunes branchés, les amoureux de l'Amérique du Sud et les déçus du rock", diagnostique Rémi Kolpa Kopoul, animateur à Radio Nova et organisateur de soirées salsa à la Coupole, un club parisien à la mode. "Je devais faire quatre soirées. Cela fait quatre ans que j'y suis", avoue avec fierté cet accro des sons latins.
Mais la dimension créative et chaleureuse de la salsa, fruit de la rencontre dans les années 60 des musiques portoricaines et cubaines avec les big bands de jazz du Spanish Harlem (quartier latin de New York) qui embrasa toute l'Amérique latine et les Caraïbes n'est pas la seule explication au succès du genre. Après la législation du dollar en 1993 à Cuba, le gouvernement de Fidel Castro montre des signes d'ouverture vers le monde extérieur. Fer de lance de la culture cubaine, la salsa qui fut longtemps bannie des Conservatoires de musique de l'île (car jugée comme un avatar du "son" concocté par des exilés ayant fui le régime) est aujourd'hui à l'honneur. La Société nationale d'enregistrement et d'éditions musicales (EGREM) vient d'ouvrir un nouveau studio à la Havane et Cuba exporte aujourd'hui ses artistes par le biais de l'agence Artex.
Cette volonté soudaine d'exporter massivement sa culture pousse le régime castriste à des excès dignes du libéralisme le plus sauvage. Fixé officiellement à 10 dollars par jour et par musicien (63 FF environ par jour), le cachet des artistes cubains suscite l'intérêt des producteurs occidentaux et asiatiques qui se bousculent à la Havane mais provoquent la colère des autres salseros : le puissant lobby des exilés cubains de Floride fait barrage aux "envoyés de Fidel", utilisant parfois la force pour empêcher leur venue. Une attitude qui pourrait faire tache d'huile en Amérique latine et porter préjudice à l'image de convivialité de la salsa.
Sylvie Clerfeuille (MFI)