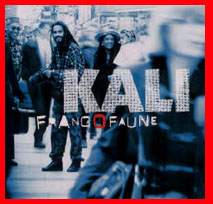Kali

Kali, le martiniquais est l'une des figures les plus charismatiques de l'île. En concert au New-Morning le 6 février, le musicien au banjo présentera son dernier album "FrancOfaune" (en partenariat avec RFI), soit l'aboutissement de 25 ans de carrière et de recherche sur les musiques qui se jouent en Martinique, le reggae, le tambour (bélé), le makossa, la mazurka ou le zouk-love. A l'image de la très belle chanson "Kreyol" sur un rythme de mazurka. Même si Kali affiche sa réticence à devoir donner à tout prix un nom à sa musique, celle qui lui irait le mieux est sans doute Reggae Dom-Tom.
La révolte en langueur
Kali, le martiniquais est l'une des figures les plus charismatiques de l'île. En concert au New-Morning le 6 février, le musicien au banjo présentera son dernier album "FrancOfaune" (en partenariat avec RFI), soit l'aboutissement de 25 ans de carrière et de recherche sur les musiques qui se jouent en Martinique, le reggae, le tambour (bélé), le makossa, la mazurka ou le zouk-love. A l'image de la très belle chanson "Kreyol" sur un rythme de mazurka. Même si Kali affiche sa réticence à devoir donner à tout prix un nom à sa musique, celle qui lui irait le mieux est sans doute Reggae Dom-Tom.
RFI Musique : Toujours fidèle au reggae, "FrancOfaune" s'ouvre par un hommage à Bob Marley avec le titre "Brother Bob"…
Kali : Bob Marley a été la révélation de l'identité caribéenne et une nouvelle voix pour tous les jeunes comme moi dès 79. C'était quelqu'un qui nous parlait avec des mots simples, sa façon de chanter était une éducation sur le tempo, musicalement, il a été un guide et avec lui, le tempo m'est apparu plus net et précis. Ce fut une approche internationale de la musique et elle m'a permis de trouver mon identité propre en tant que caribéen et je crois, rasta.
Pourtant, vous écoutiez du calypso, de la biguine, du compas?
Oui, bien sûr, mais avant Bob Marley, aux Antilles, nous n'avions aucun schéma auquel nous pouvions nous identifier. Nous écoutions les chanteurs français yé-yé des années 60, nous lisions les romans photos style Nous deux(!) (magazine français : ndrl), enfin rien dans lequel nous pouvions nous identifier. Puis, est venue la révolution afro-américaine avec les Blacks Panthers, Angela Davis, Isaac Hayes, etc... mais on n'avait aucune image de musique martiniquaise car il n'en passait pas à la radio, seulement de la musique française ou latino.
Bob Marley, déclencheur d'une recherche identitaire ?
Bob Marley est arrivé à temps car je commençais à m'intéresser à Gandhi. A la fois pour son parcours non-violent et de grand révolutionnaire. Il a réussi à changer les choses. C'est ce qui m'intéressait car moi aussi, je voulais faire prendre conscience aux martiniquais d'où ils venaient. Qu'ils avaient des racines françaises bien sûr, mais aussi africaines. Marley est arrivé comme un sauveur et lorsqu'aux Antilles, on a vu arriver ce métis qui prônait la paix, j'ai su que c'était ça que je voulais être.
Etre rasta, c'est un courant philosophique ?
Je lis la Bible mais je ne crie pas sur tous les toits que je suis rasta, j'essaie de me conformer et de ne pas prononcer le nom du Seigneur toutes les cinq minutes. Le but, c'est de transmettre la joie et la paix autour de nous ; si une seule âme n'est pas en paix, c'est qu'il y a un problème quelque part. Bob Marley est le seul être qui ait parlé de Dieu avec force et majesté. Avec sa gloire il a éclairé toute la terre, des indiens Buffalos aux esquimaux du Grand Nord. En Corée du sud ou dans une tribu africaine du Soudan, il y aura toujours quelqu'un pour écouter une cassette de Bob Marley. En ce sens, c'est vraiment un prophète. On sait que Dieu a dit de rassembler les hommes sur terre et si l'on suit l'apocalypse, on en connaît la fin.
Vous vous êtes impliqué dans les commérations pour l'abolition de l'esclavage ?
Dans ce disque, à ma manière. J'ai aussi été invité avec Malavoi pour les festivités de Champagney (France). Bien sûr, cela a servi à rafraîchir la mémoire des gens, mais on reste toujours esclave, toi, moi… Les bretons étaient aussi esclaves à Saint-Barthélémy (île française des Caraïbes : ndrl). Nous ne sommes pas maîtres de nos décisions, on est esclave du monde moderne, les martiniquais ont tous leurs 4X4 mais en écologie tout reste à faire, peu de choses existent pour les enfants par exemple. Arrêtons d'être assisté.
Comment vous investivez-vous dans la sauvegarde de la musique martiniquaise ?
Je suis retourné au pays car j'ai monté un petit studio de musique traditionnelle, celle que les producteurs ne veulent pas produire. C'est dans la montagne, dans un endroit qui s'appelle Balata, en direction du Morne rouge. Je fais cela car j'ai envie d'aider les martiniquais qui jouent de la musique traditionnelle mais à qui l'on ne donne pas la possibilité d'enregistrer. On joue du tambour martiniquais, le bélé (ou belair) qui est d'origine africaine, de Guinée et du Congo. Les tambours africains étaient construits dans des troncs d'arbres, les nôtres le sont dans des fûts qui servaient à transporter toute la salaison qui venait de métropole. Ces fûts sont devenus la matière première des esclaves pour faire les tambours. Ce tambour a donné une particularité à notre musique, qui a beaucoup servi pour la danse car il existe 14 rythmes différents. Le tambour bélé existe parce que c'est une façon de vivre, une façon de penser et ça reprend naissance dans les foyers.
Qu'est ce qui fait que Kali chante en créole ou en français ?
Même si je prône le créole comme langue officielle, les titres de mes chansons viennent souvent en français. Lors de la composition, la musique vient d'abord puis ensuite les paroles, pour mon précédent album "Racines", l'inspiration est venue en français mais c'est Dieu qui me donne les musiques. En l'occurrence, sur "FrancOfaune", six titres sont en français et quatre en créole. Pour les plus belles et les plus fortes des chansons, musiques et paroles viennent ensemble. Je suis aussi aidé par mon parolier français, Rémi Bellenchombre avec qui je travaille depuis 1979. C'est lui qui m'a offert le banjo de son père qui venait de mourir. Grâce à Rémi, j'ai découvert cet instrument qui ne me quitte plus.
Une chanson comme "Reggae Dom-Tom", à l'époque de votre ancienne formation "6th Continent", est-elle toujours d'actualité ?
Chaque fois que je joue cette chanson, je me dis, c'est pas vrai, elle a déjà vingt ans. Quand on chantait :"Je suis vraiment d'une race très spéciale, je suis un nègre départemental, passionné par le style colonial", cela avait quelque chose de subversif mais qui reste malgré tout d'actualité. J'ai fait une autre chanson qui est toute aussi prophétique,"Ile à vendre", dans laquelle je tournais en dérision la façon de vendre des vendeurs... A ma façon, je vendais l'île avec des paramètres bien particuliers : "les révolutionnaires sont fonctionnaires, les éruptions sont programmées, les serpents sont anesthésiés... ".
C'est toujours l'ironie qui pointe derrière ce titre "FrancOfaune" ?
Oui et non. La faune, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de musiciens invités sur le disque, à commencer par Manu Dibango et Jerry Malékani. Et puis l'idée m'est venue lorsqu'un soir dans le métro, gare du Nord à Paris, avec mon bassiste, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un blanc parmi les voyageurs. Sur le quai en face de nous, il n'y avait que des africains, des asiatiques. La faune, c'est aussi ce mélange, avec ce côté un peu sauvage, non sans ironie, mais surtout parce que toutes ces races-là parlent le français et vivent en France. Moi et mes musiciens, nous faisons aussi partie de cette faune.
(…)
Le mélange des origines, vous connaissez bien…
Je suis un vrai créole. Avec des origines françaises portugaises et africaines, la famille de ma grand-mère, Bernadette Marques, venait du Brésil. Mon père était français. Sauf que tout le monde pense que j'ai des origines indiennes, mais non. Le créole, c'est une race mélangée, nous sommes le résultat d'une fausse équation. Ce n'était pas voulu. Maintenant la langue créole, c'est une façon de dominer la Caraïbe. Pourtant jusqu'à l'âge de 13 ans, je prenais des coups lorsque je parlais créole.
Pourquoi ce nom Kali ?
A mes tous débuts, on m'appelait Caliméro car à l'école je trouvais tout trop injuste... Puis on a coupé le nom, trop long, qui est devenu Kali. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que Kali était la déesse indienne de la destruction du mal. Cela me ressemble bien. Me battre pour les causes perdues.
En partenariat avec RFI FrancOfaune (Déclic)