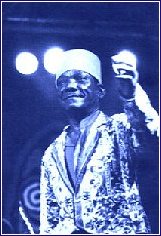FESTIVAL D'ANGOULÊME

La 24ème édition des Musiques Métisses en Charente s’est achevé ce lundi 24 mai avec une excellente programmation qui a pris ses marques dès 14h30 par un concert acoustique du groupe Vaovy de Madagascar. On parlera probablement d’un final en beauté pour un festival qui se veut l’expression vivante des Musiques Métisses en devenir. Dans le désordre, on retiendra Compress 220 V de Guyane, Susana Baca du Pérou, Boubacar Traoré du Mali et Toto la Momposina pour la Colombie. On notera pour ce soir l’hommage appuyé que Christian Mousset, patron de ce rendez-vous des cultures plurielles en Charente, rend à Cuba avec Asere, Estrella de la Charanga et l’Orquesta Aragon. On n’oubliera surtout pas de rappeler la dernière prestation du groupe Vaovy de Madagascar, qui venait clore cet après-midi la partie du programme consacrée aux artistes des îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien.
Six/huit en musique...
La 24ème édition des Musiques Métisses en Charente s’est achevé ce lundi 24 mai avec une excellente programmation qui a pris ses marques dès 14h30 par un concert acoustique du groupe Vaovy de Madagascar. On parlera probablement d’un final en beauté pour un festival qui se veut l’expression vivante des Musiques Métisses en devenir. Dans le désordre, on retiendra Compress 220 V de Guyane, Susana Baca du Pérou, Boubacar Traoré du Mali et Toto la Momposina pour la Colombie. On notera pour ce soir l’hommage appuyé que Christian Mousset, patron de ce rendez-vous des cultures plurielles en Charente, rend à Cuba avec Asere, Estrella de la Charanga et l’Orquesta Aragon. On n’oubliera surtout pas de rappeler la dernière prestation du groupe Vaovy de Madagascar, qui venait clore cet après-midi la partie du programme consacrée aux artistes des îles du Sud-Ouest de l’Océan Indien.
Fondé il y a environ un quart de siècle, Vaovy est une formation qui s’appuie sur un art vocal typique de la culture Antandroy: une entité complexe parmi les dix-huit qui existent sur l’île rouge. Son leader, Jean Gabin Fanovona, est un ancien chef de chorale protestante, qui mise aujourd’hui sur une certaine pratique traditionnelle, tout en essayant de renouveler le patrimoine. Il puise dans le répertoire des chants funéraires et privilégie une certaine instrumentation (le violon dit Lokanga et la harpe marovany entre autres), à laquelle il ajoute l’harmonica ou l’accordéon par exemple pour mieux marquer son évolution. L’inspiration est authentique, le tempo énergique et la rythmique en six/huit. Une formule océano-indienne qui a fait, il est vrai, ses preuves dans l’histoire de ce festival, notamment durant cette édition. Il n’y a rien d’étonnant en tout cas à ce que son répertoire, qui témoigne du commun des gardiens de zébu, séduise. Il y a quatre ans, le groupe avait déjà signé une belle prestation sur l’île des Bourgines, où sont installés les chapiteaux de Musiques Métisses. Ses prestations d’hier et d’aujourd’hui n’ont fait que confirmer son talent.
Dimanche, le festival a accueilli deux autres artistes malgaches. Le premier, Régis Gizavo (photo), est l’accordéoniste le plus coté de l’île. Enfant du pays vezo (une autre entité malgache), il a reçu son enseignement instrumental du père, a écumé les bals avec le «piano du pauvre», avant d’être consacré il y a neuf ans par le concours Découverte RFI. Déjà entrevu aux côtés du groupe corse I Muvrini et de Graeme Allright, Régis, auteur en 95 d’un album très remarqué («Mikéa») dans le milieu mitigé de la world est aussi un grand architecte en matière de sons mélangés. Avec lui, Madagascar et ses angoisses voyagent. Son swing s’est toujours inscrit dans les échanges réussis entre le Nord et le Sud… Et entre le Sud et le Sud surtout. L’influence des voix zulu ou encore l’importance des modes rythmiques bantu dans ses compositions l’attestent.
Le second artiste, surnommé Ratzery, est un surdoué au valiha : une harpe tubulaire, anciennement prisée dans la cour des rois mérina, avant d’être mise sous l’influence des courants étrangers (la musique de salon occidentale, entre autres influences). Elle est devenue en fait l’instrument malgache par excellence, depuis de très longues années. Auteur-compositeur, Ratzery joue en trio et adore lui aussi raconter des histoires de zébus dans ses textes, quand il ne dénonce pas les misères du quotidien. Son inspiration se revendique des entités Betsimisaraka, Betsileo et Sakalava. Sur scène, il fait preuve d’une grande habileté dans ses interprétation «diatoniques» du valiha, malgré un handicap évident (il a perdu une de ses mains lorsqu’il était minot).
L’Océan Indien aux Musiques Métisses ne s’arrête, bien sûr pas à Madagascar. L’île de La Réunion est aussi représentée dans la programmation de cette 24ème édition. Par deux formations : Baster et Gramoun Lélé (photo). Adeptes d’une rencontre possible entre le reggae et le maloya, les membres de Baster étaient sur la scène du Mandingue lundi soir. Mais dans la longue suite des traditions revisitées et renouvelées, on retiendra probablement le maloya du clan Gramoun. Dirigée par le père Philéas, le groove ternaire des esclaves noirs que la censure coloniale ne sut jamais étouffer, a littéralement enflammé les habitués du festival vendredi et samedi derniers. Voix puissante du patriarche, choeurs qui s’extasient, kayamb qui s’énerve, rouleur, pikèr, triangle… autant d’instruments qui miment les sonorités percussives de la ronde à pas de 6/8. Un chant qui parle du quotidien. Du chômage qui fait rage. Des femmes avides de sous. Sans oublier de rendre hommage aux ancêtres esclaves. Avec Philéas et sa marmaille, le rythme au tempo lourd de sens, issu des champs de canne, réinvente l’esprit des fêtes kabare à Angoulême, une ville où la communauté réunionnaise est assez présente.
Soeuf Elbadawi.