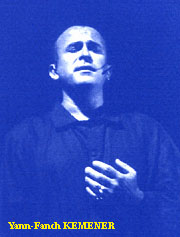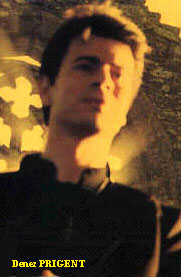Voix de Bretagne

Les chanteurs traditionnels bretons multiplient les entreprises audacieuses, les rencontres enrichissantes et les nouvelles directions de recherche. Comme chaque année, «Voix de Bretagne» rassemblait pour trois jours à Paris, à la Cité de la Musique, six chanteurs sur la même scène, en attendant une représentation le 1er avril au Quartz de Brest. Nouveautés et fidélités dans une culture où la tradition est tout, sauf traditionnaliste.
Etat des lieux de la révolution traditionnelle
Les chanteurs traditionnels bretons multiplient les entreprises audacieuses, les rencontres enrichissantes et les nouvelles directions de recherche. Comme chaque année, «Voix de Bretagne» rassemblait pour trois jours à Paris, à la Cité de la Musique, six chanteurs sur la même scène, en attendant une représentation le 1er avril au Quartz de Brest. Nouveautés et fidélités dans une culture où la tradition est tout, sauf traditionnaliste.
Une fois par an, depuis 1992, «Voix de Bretagne» fait l'état des lieux du chant traditionnel breton, à l'initiative du Quartz de Brest et en liaison avec une institution parisienne (le Théâtre de la Ville jusqu'à 1999, la Cité de la Musique cette année). Chaque fois, en deux heures de spectacle, les générations sont mêlées ou confrontées, les pratiques les plus rustiques côtoient les recherches les plus novatrices.
Cette année, aucun grand aîné au programme, mais six voix qui ont toutes en commun l'invention, la rigueur musicale et la liberté formelle. D'abord, trois chanteurs de la première génération des réinventions : les quadragénaires Manu Lann Huel, Erik Marchand et Yann-Franch Kemener.
Le premier, accompagné par le merveilleux sonneur Patrick Mollard, fait se rencontrer le pibroch - musique classique écossaise pour grande cornemuse - et la poésie bretonne, avec textes de sa plume ou la légendaire Confession de Gwenc'hlan, plus ancien texte breton médiéval connu. Chanteur souvent bouillonnant lorsqu'il s'exprime en français, Manu Lann Huel incarnait ici - minéral, hiératique -, l'aspect le plus austère, le plus savant, de la tradition bretonne d'aujourd'hui.
Inversement, Erik Marchand a ouvert depuis vingt ans la tradition du chant à danser à mille confrontations festives. Il avait ainsi invité son vieux complice Thierry Robin, virtuose du oud et du bouzouk, ainsi que Hasan Yarim Dunia, maître tsigane turc de la clarinette : invention d'un entre-deux de l'Extrême-Occident français et de l'Orient européen, découverte d'une homogénéité paradoxale des plaisirs dansants entre la Bretagne traditionnelle et le pan-orientalisme tsigane...
Troisième «chercheur» de cette génération, Yann-Fanch Kemener présentait les premiers résultats de son compagnonnage avec le violoncelliste Vincent Segal. Après avoir travaillé plusieurs années la gwerz (la complainte épique ou romanesque bretonne) en compagnie du pianiste Didier Squiban, il travaille maintenant avec un instrument dont le timbre et la tessiture ne sont pas éloignés de la voix humaine. Ainsi, la parenté joue à plein dans les agiletés du kan a diskan, chant à danser d'ordinaire interprété à deux ou trois interprètes. La savante rigueur, le métissage inter-traditionnel, l'exploration des timbres : trois orientations innovantes différentes pour des chanteurs qui savent aussi pratiquer le bal et les traditions les plus rustiques.
La seconde moitié de «Voix de Bretagne» confrontait trois entreprises plus «modernes». D'abord, Kristen Nicolas incarne une vision à la fois éthérée et pop de la tradition bretonne. Pieds nus, barbu, vêtu d'un gilet assez «baba cool», il défend avec quelques manières et un engagement assez tarabiscoté une musique à mi-chemin de la pop des années 70 et de la vision folk-rock de la Bretagne que portait longtemps Alan Stivell.
Ensuite venaient Annie Ebrel et Riccardo Del Fra, qui ont été la plus remarquée des confrontations d'univers dans le domaine traditionnel ces deux dernières années en France : une des rares jeunes chanteuses à venir d'un terroir réellement bretonnant et un contrebassiste de jazz réputé se sont découverts un territoire commun. Face à face sur scène, ils dialoguent et tressent deux langues musicales en une commune expression, sévère et douce.
Enfin, l'événement était attendu de Denez Prigent. Depuis une demi-douzaine d'années, il ouvre voie neuve après voie neuve, précautionneux et audacieux à la fois. Reconnu comme un des meilleurs chanteurs de gwerz en Bretagne, il a beaucoup flirté avec le jazz improvisé et avec la techno. Ici, il était accompagné du joueur de bombarde David Pasquet et surtout de Valentin Clastrier, magistral magicien de la vielle électroacoustique - la refonte moderne de l'antique vielle à roue des campagnes. Et, outre la démonstration de l'agileté phénoménale de Prigent dans un kan a diskan en solo, la performance technique - et technologique - de Clastrier, on notera la découverte de nouveaux paysages. Chant non mesuré, la gwerz s'accorde de beaucoup de structures harmoniques possibles, laisse de grands espaces à l'improvisation collective. Et Prigent, Clastrier et Pasquet ont ainsi interprété ensemble une pièce aux horizons immenses, majestueuse invention qui aurait aussi bien pu être la bande son d'une gigantesque bataille de Kurosawa que la symbolique de l'éveil celtique de ces dernières années, enraciné et ouvert aux plus riches apports.