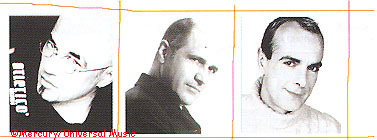Les Dix commandements

Des comédies musicales lancées à la rentrée, Les Dix Commandements, mise en scène par Elie Chouraqui sur des musiques de Pascal Obispo, est sans doute le succès le plus net : lourdes ventes d’albums (jusqu'à la deuxième du classement Ifop), salles pleines au Palais des Sports de la Porte de Versailles... Mais, avec son énorme décor égyptien et ses mélodies tout en majuscules, Les Dix Commandements manquent à la fois de gravité et de légèreté.
Le pompier et l’allégé
Des comédies musicales lancées à la rentrée, Les Dix Commandements, mise en scène par Elie Chouraqui sur des musiques de Pascal Obispo, est sans doute le succès le plus net : lourdes ventes d’albums (jusqu'à la deuxième du classement Ifop), salles pleines au Palais des Sports de la Porte de Versailles... Mais, avec son énorme décor égyptien et ses mélodies tout en majuscules, Les Dix Commandements manquent à la fois de gravité et de légèreté.
Attardons-nous d’abord à un détail : dans Les Dix commandements, il n’y a que neuf commandements. Les églises chrétiennes se sont posées beaucoup de questions, au cours des siècles, sur le nombre de commandements contenus dans le chapitre 20 de l’Exode, dans la Bible. Les catholiques et la plupart des protestants en comptent dix en séparant «tu n’auras pas d’autres dieux devant moi» et «tu ne te feras aucune image sculptée», tandis que les orthodoxes incluent ces deux défenses dans un seul commandement mais séparent «tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain» et «tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain». Lionel Florence et Patrice Guirao, les paroliers des Dix commandements, se sont simplifié la vie en réduisant la liste à neuf préceptes d’une rédaction parfois un peu opaque (« Ne trompe pour personne/Cet autre que tu as choisi», c’est moins clair que «tu ne commettras pas d’adultère»).
Un décalogue allégé, ce n’est pas bon signe. Pourtant, en arrivant au Palais des Sports, l’atmosphère est plutôt à l’opulence, au grand geste, aux largesses. Un immense plateau, un énorme décor d’Egypte antique : on se prend à rêver des fantaisies pittoresques inventées jadis pour Astérix et Cléopâtre, comme le fameux Lion de Cléopâtre chanté par Roger Carel.
Mais, ici, il n’y a guère de place pour la fantaisie, pour la gaieté, pour le petit refrain joyeux qui délasse. Les Dix Commandements est une affaire d’un sérieux papal, hérissée de majuscules. Pourtant, les moyens sont imposants : de larges écrans vidéo diffusent des images en grand format (cela évoque un peu les diaporamas de Connaissance du monde, d’ailleurs), la troupe est nombreuse... On regrettera que la chorégraphie soit d’une telle pauvreté et les danseuses aussi mal coordonnées, mais elles constituent, individuellement, un divertissement plastique agréable. En revanche, les quatre acrobates-capoéristes sont enthousiasmants.
En général, les chansons composées par Pascal Obispo ont ce défaut de toujours sembler clore le spectacle. Chaque chanson est une montée vers un final d’une ampleur panoramique : larges hurlements d’amour, vastes déclarations enflées, notes forcées... Le spectacle avance ainsi d’apogée en apogée, sans que jamais la tension sentimentaliste ne se relâche. Heureusement Pascal Obispo, s’il travaille toujours la même pâte mélodique, a varié les arrangements (les interprètes chantant avec un accompagnement pré-enregistré).
Pour ne pas heurter l’oreille (à part par le volume, assez déraisonnable), il a toujours mêlé les esthétiques : une guitare rock sur une rythmique French touch, bric-à-brac world music et drum’n bass... Ainsi, le tableau du veau d’or, au cours duquel on voit çà et là un sein dénudé, présente une mélodie de salle de gym avec de nombreuses allusions aux années psychédéliques (d’un point de vue idéologique, on peut noter le caractère vaguement réactionnaire de ce choix, qui renvoie toute la libération des mœurs aux noirceurs de l’idolâtrie païenne, l’hédonisme libertaire des années 60 aux seules œuvres du Malin). Le côté aérobic des mouvements d’ensemble est caricatural lorsque les Hébreux quittent l’Egypte : alors qu’on attend un chœur martial et héroïque, on reçoit un petit refrain bêta plus propice aux exercices de step qu’à galvaniser un peuple (« Pour vivre enfin vivre/V. I. V. R. E./Pour vivre enfin libre/L. I. B. R. E. »). Et cela révèle un goût plus prononcé pour la clameur que pour le chœur.
Ce qui agace véritablement dans ce spectacle est l’absence de caractère de l’interprétation, l’interchangeabilité des chanteurs : si l’on ferme les yeux dans Mais tu t’en vas, dans lequel Séphora, Bithia, Nefertari et Miryam alternent chacune un couplet, trois des quatre voix se confondent parfaitement ; Moïse et Ramsès chantent leurs duos dans la même tessiture et avec des timbres trop proches... Au fond, tous les garçons chantent comme Patrick Fiori et toutes les filles comme Hélène Ségara, ce qui laisse une sensation d’uniformité qui, à la fois, est frustrante pour qui aime la musique ; et explique le succès public d’une comédie musicale qui laisse les critiques français plutôt dubitatifs.
C’est l’affirmation - parfaitement assumée par Obispo, d’ailleurs - de cet art pompier d’aujourd’hui, saturé de sentiments qui apparaissent d’autant meilleurs qu’ils sont braillés, d’autant plus beaux qu’ils s’accompagnent de grands gestes des bras, d’autant plus sincères qu’ils se rapprochent du sanglot. Mais ce n’est plus, alors, le champ d’appréciation des critiques de musique, mais celui des sociologues.
Bertrand DICALE