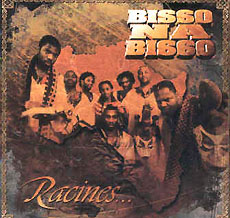Sénérap

Le trio sénégalais Djoloff lâche son authentique flow depuis la région parisienne. Un nouvel album pour un troisième millénaire qui s'annonce meilleur pour la scène hip hop africaine dans son ensemble. Avec Dakar comme chef-lieu incontournable. Simplement parce que c'est la ville qui exporte le plus de tchatcheurs. Revue de détail.
Djoloff & co.
Le trio sénégalais Djoloff lâche son authentique flow depuis la région parisienne. Un nouvel album pour un troisième millénaire qui s'annonce meilleur pour la scène hip hop africaine dans son ensemble. Avec Dakar comme chef-lieu incontournable. Simplement parce que c'est la ville qui exporte le plus de tchatcheurs. Revue de détail.
Tassou, takhourane ou lawane…des mots en wolof qui sonnent bizarres aux oreilles du mélomane rap non averti. Il s'agit pourtant de traditions de toasteurs situés non loin du débit rap. Des pratiques issues du patrimoine séculaire sénégalais que les soldats du groupe Djoloff ont remis au goût du jour. Dynamique de ressourcement, soutenue sur certains morceaux par le ngoni à trois cordes de Moriba Koïta, les percus chaudes de Pape Dieye, la kora de Yacouba Cissoko, sous la bénédiction artistique du frère Wasis Diop, passé maître es fusion Nord et Sud. Autant dire que Mbegane, Doudou et Aumar, les trois lascars du groupe, ont voulu mettre la barre très haute. Débarqués en France il y a quelques années, ils n'ont jamais voulu se laisser noyer par les vagues rap ambiantes. Ils ont toujours cherché à cultiver une certaine originalité, qui tire ses principales forces du bled d'origine. Etre immigré ne veut aucunement dire s'assimiler. Djoloff vit en région parisienne mais n'oublie pas ses racines africaines. D'où une certaine authenticité qui irrigue les dix titres de l'album.
Lawane, titre-emblème de ce nouvel opus, prend sa source dans un chant griotique dédié aux guerriers. Une missive qui résumerait à elle seule la charge portée par les textes. Pas de raccourcis racoleurs sur des histoires de béton urbain déprimant, pas de clins d'œil faciles non plus à la banlieue souffrante qui les entoure… Le trio parle de retrouver sa mémoire déracinée, s'interroge sur l'Afrique des génocides, invoque Sankara ou Mandela pour mieux vilipender les politiciens sans honneur. Il parle avec amertume et avec des mots à peine voilés (pour qui connaît l'histoire du Continent Noir) de ceux qui trahissent : "Le vieux Nègre a trop crié sa négritude et au moment où il a fallu secourir son peuple, il a oublié ses idées pour une place à l'Académie des Maîtres". Ils s'en prennent radicalement à leurs contemporains et à leur lâcheté intellectuelle : "Le règne des nègres et des vautours a sonné en Afrique". A méditer ou à écouter en boucle sur l'album, on a le choix. Djoloff se situe volontiers dans la génération du refus, "à qui on demande d'assumer seule les conséquences de l'histoire d'un continent". Discours politique, le rap, quand il sort des querelles ineptes du show-biz triomphant, sait garder une morale digne de foi, en exprimant toute sa rage originelle. C'est ce qui explique son succès inattendu dans l'Afrique des jeunes générations. Le rap libère leurs langues, les fait tanguer dans des postures qui miment une totale rupture avec leurs aînés. On ne compte plus le nombre de productions ou d'autoproductions qui sortent. La scène la plus prolifique demeure cependant celle du Sénégal d'où viennent les Djoloff, qui y négocient la tête d'affiche avec Daara-J et Positive Black Soul.
Ces derniers sortent leur second album sur la scène internationale (Run Cool), enregistré à New York, avec Princess Erika et Ki Mani Marley (fils de Bob) en invités d'honneur. Les temps changent. Les temples anglo-saxons du hip hop croulent sous les sorties et perdent en originalité, avec une fâcheuse tendance à jouer le jeu de la variété pour mieux écouler ses stocks. La France, deuxième marché mondial en termes de ventes de disques, n'est pas loin de vouloir imiter cette tendance. Du coup, lorsque les jeunes Africains débarquent avec leur flow et leurs étranges sonorités écartelées entre deux mondes (Europe/ Occident), voire entre trois mondes (si on compte le Maghreb et l'Orient), ils déstabilisent forcément.
Ils sont nombreux
Il faudra encore quelques années pour établir un quelconque bilan. Mais d'ores et déjà, on sait que la dynamique amorcée porte ses fruits. Le rayonnement planétaire ne serait pas loin, si les maisons de disques s'y mettaient sérieusement. Or c'est toujours là que le bât blesse pour toutes les musiques venues du Sud. Il faut attendre que les studios et les managers des pays du Nord se décident à investir pour que les ventes s'enflamment. En attendant, les rangs s'élargissent. Rien qu'à Dakar, on compte à ce jour plus de 1500 groupes. On se rappelle encore de ces jeunes possees, poussés par Youssou N'Dour sur la compilation Da hop (Jololi/Delabel), qui va probablement devenir le phare durant les cinq prochaines années du rap d'Afrique de l'Ouest, comme jadis avec la compil' Rapattitude en France dans les années 80. Pas de crise identitaire sur cet opus, juste une envie de rappeler que l'imitation servile des influences occidentales n'est pas de mise dans la région. Le résultat est même déroutant : on a l'impression que le wolof est une langue finalement taillée pour porter le message du hip hop. Rap et même ragga, engloutis par le mbalax pays et ses illuminations percussives, mélodies inspirées par un patrimoine ancestral. Le discours n'oublie jamais de rappeler les deux mamelles de cette révolution sonore : racines et foi en l'avenir. Il suffit d'écouter Ndekheté, le titre de Bideew Bou Bess, qui ouvre l'album Da Hop pour s'en convaincre.
Derrière les Sénégalais, s'engouffrent d'autres rappeurs africains. L'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud sont autant de pays atteints de plein fouet par le beat urbain. On peut le dire sans se méprendre : les jeunes Africains, trouvant le rap plus accessible comparé à d'autres musiques plus classiques, ont succombé au charme. C'est une musique qui leur semble au départ peu contraignante en termes de production et de moyens (une platine et un micro pour les moins bien lotis). Par la suite, le refus du mimétisme avec les modèles occidentaux laisse place à une plus grande ambition : réconcilier cette musique avec des pratiques plus anciennes et plus authentiques (qui vont de la pratique de vrais instruments aux rythmiques authentiques et séculaires), d'où l'émergence d'un rap original et frais. Les Djoloff ne sont qu'un exemple parmi d'autres.
Cela dit, on peut craindre aussi que certaines maisons de disques par gourmandise viennent maladroitement miser au bout d'un certain temps sur cette world attitude du hip hop, sans tenir compte de sa particularité. Zouk, rumba, salsa, chaâbi, des musiques populaires seraient alors systématiquement revisitées par les rappeurs, avec le risque certain d'ouvrir la porte à des formes de marketing opportuniste de la part des producteurs les plus inspirés. Il suffirait alors de reprendre de vieux sons ou des musiques actuelles supposées plus ancrées dans les terroirs mais moins urbaines, on les maquillerait avec deux rappeurs et on fabriquerait les tubes à venir... Fusion plus ou moins réussie entre les genres, exotisme à la carte pour fanatiques mélomanes de rap, ouverture plus grande du hip hop pour un public plus large, les calculatrices après tout ont le droit de fonctionner à temps plein.
Heureusement, quelques ténors veillent et découragent pour l'instant les spéculations abusives. Le mouvement sur le continent a de toutes manières, engendré quelques succès qui laissent l'underground international songeur. Par certains aspects, ce rap bénéficie d'une véritable alchimie sonore qui surprend, dans la mesure où il puise dans un patrimoine à la fois occidental et africain. Très peu de samples (vinyls introuvables sur les marchés locaux), du son roots (les machines sont ainsi remplacées parfois par de véritables musiciens) et un flow urbain qui tient énormément compte de la réalité sociale des différentes contrées.
Comme jadis avec le reggae et l'exportation du mouvement rasta dans le monde, nous assistons à un réel travail de réappropriation d'une musique importée en Afrique. Le hip hop s'apprivoise et s'enrichit par conséquent, avec des sons de terroir périphérique (le centre étant l'Euro-Amérique). Quelques rappeurs, enfants d'immigrés d'origine afro, vivant en France, se sont rendus compte de cette force, en allant se ressourcer notamment pour un album référence (Racine du Bisso Na Bisso) dans le patrimoine urbain et populaire de l'Afrique qui mue. Mieux, Passi, l'idole français des 12/24 ans, l'homme à la tête de cette équipée du Bisso, produit actuellement le premier opus du groupe sénégalais Bedeew Bou Bess, l'un des fleurons de la scène dakaroise. Le deal avec les maisons de disque est en cours. Affaire à suivre de près, en ce début de troisième millénaire.
Soeuf Elbadawi
Lawane de Djoloff (Emma Production/ Universal)
Run cool de PBS (East West)
Da hop (Jololi/ Delabel)