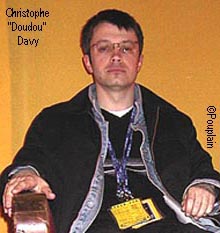LE PRINTEMPS DE BOURGES

Bourges, le 18 avril 2001 – Après un quart de siècle d’une vie riche et agitée, après de récents aléas financiers et une certaine désaffection du public, le festival du Printemps de Bourges aborde le nouveau siècle avec une jeunesse retrouvée, celle, entre autres, des nouveaux programmateurs, Manu Baron et Christophe Davy, qui ont finement recadré les objectifs de la manifestation. Mardi 17 avril, le Printemps ouvrait son vingt-cinquième épisode sous un temps clément. Au programme, peu de stars et beaucoup de talents.
Un festival 'généraliste et pointu'
Bourges, le 18 avril 2001 – Après un quart de siècle d’une vie riche et agitée, après de récents aléas financiers et une certaine désaffection du public, le festival du Printemps de Bourges aborde le nouveau siècle avec une jeunesse retrouvée, celle, entre autres, des nouveaux programmateurs, Manu Baron et Christophe Davy, qui ont finement recadré les objectifs de la manifestation. Mardi 17 avril, le Printemps ouvrait son vingt-cinquième épisode sous un temps clément. Au programme, peu de stars et beaucoup de talents.
Le Printemps de Bourges, c’est un festival quasi-culte. Dans cette petite ville du Berry célèbre pour son centre ville du XVème siècle, on rencontre en avril un tas de vieux briscards qui se connaissent tous et échangent leurs souvenirs des premières éditions, à l’époque où le Printemps faisait gaillardement 15 à 20.000 entrées (contre environ 60.000 aujourd’hui), à l’époque où Daniel Colling, patron et patriarche du festival, et son équipe voulaient offrir un lieu pour les artistes déjà connus (Higelin, Renaud, Lavilliers, Couture, Thiéfaine,…) mais absent du circuit médiatique oscillant alors entre le populisme de Guy Lux et les paillettes des mythiques shows produits par Maritie et Gilbert Carpentier.
Vingt-cinq Printemps plus tard, le festival se remet de ses hauts (120.000 entrées en 86) et de ses bas (il a frôlé le dépôt de bilan en 89). En 2001, il retrouve un rythme de croisière après une certaine désaffection du public à la fin des années 90. Trop de stars, pas assez de recherche musicale, moins de public, carrément moins d’argent... Il y a urgence.
Il y a trois ans, Daniel Colling prend son téléphone et appelle au chevet d’une programmation morose deux jeunes figures de l’industrie musicale, Manu Baron et Christophe Davy dit Doudou, aujourd’hui producteur de Miossec : « C’est simple, il connaissait déjà Manu pour avoir travaillé avec lui sur une programmation électro du Printemps, raconte Christophe. Il cherchait une autre personne avec des sensibilités complémentaires pour faire la programmation. J’ai dit oui, c’était une super opportunité. »
Alors que le nom de Manu Baron, 31 ans, est associé à la scène électronique des années 90, Christophe, 34 ans, est plutôt orienté vers le rock anglo-saxon et la scène alternative française de la fin des années 80/début 90, et à la nouvelle chanson française (tendance Têtes Raides, Mickey 3D, Miossec…). A eux deux, ils mettent au point une nouvelle scène qui privilégie les musiques actuelles « au sens large du terme », développent volontairement une programmation « moins têtes d’affiche » et « artistiquement plus pointue », finit de préciser Christophe.
Pour atteindre les objectifs qu’on leur a confié, Baron et Davy prennent des décisions drastiques : « On a demandé l’ouverture de nouveaux sites pour les musiques électroniques et la fermeture de gros lieux de façon à mieux adapter la programmation. Il fallait supprimer ce qui n’était plus intéressant. » On peut dire que le festival redevient une photographie très proche des mouvements musicaux d’un moment, un vrai repaire de tribus où chacun trouve son compte, fait le plein de l’essentiel dans un domaine donné. Même si, selon Christophe, ils ont toujours le sentiment de passer à côté d’ un truc important, pour des raisons économiques ou simplement de planning.
Cette année, la scène francophone est moins présente au profit des anglo-saxons. « C ‘est la sensibilité du moment, sans volonté de quota » précise encore Christophe Davy. Mais, peu importe, tel que le veut le Printemps de Bourges, il y en a pour tous. Effectivement, alors que le premier soir, mardi 17, tous les regards (et les pieds) convergent vers l’Igloo, le chapiteau géant, pour le concert de l’ambigu trio anglo-américain Placebo, RFI Musique s’intéresse à une discrète soirée d’ouverture où deux artistes du label Tricatel, Bertrand Burgalat (créateur dudit label) et l’Allemande Ingrid Caven, nous font voyager dans le temps.
Objet d’un récent portrait dans nos cyber pages, Bertrand Burgalat est à Bourges avec son quintet, A.S. Dragon. Tel son premier album, the Ssssound of Music, la version live nous ramène à la fin des années 60. Tout y est, les coiffures façon Brian Jones, les pantalons cigarettes, les vieux amplis Marshall ou Vox, le décor pop art, on se croirait dans un épisode de la série Amicalement Votre. Burgalat a clairement le souci du détail et sa musique en est la preuve. Plus que sur l’album, la scène donne une fabuleuse amplitude à sa pop inspirée, parfois en français, parfois en anglais, souvent instru, c’est la meilleure.
Celui qui a débarqué sur la scène musicale avec un « easy listening » d’une insolente légèreté, démontre désormais un talent bien plus solide, faiseur de mélodies savantes, orchestrées avec invention et énergie. La salle renvoie malheureusement bien peu d’écho à cette prestation qui se clôt sur un chorus déchaîné et festif.
Autre ambiance, autre rappel vers certains passés avec Ingrid Caven, diva de la culture allemande des années 70, redécouverte via son écrivain de mari, Jean-Jacques Schuhl, qui obtint l’an passé la Rolls des prix littéraires français, le Goncourt, avec un roman du nom de sa compagne. Ingrid Caven, c’est du théâtre, de la dramaturgie, de la tragédie avec sa dose de dérision.
En fond de scène, elle apparaît dans sa longue robe de satin noir et démarre un spectacle d’une incroyable classe. Portée par une magnifique voix claire qui sait jouer des textes mais surtout des mélodies, Ingrid Caven nous remémore ces atmosphères mi-Dietrich mi-Fassbinder dont elle fut une des actrices fétiches (il lui offrit 11 rôles). Accompagnée d’un pianiste plus dans l’ombre que son demi-queue, la chanteuse nous présente chansons récentes, aux textes souvent signés Schuhl, et anciennes, en allemand, anglais ou français, surtout pour cette reprise singulière de Je ne regrette rien, créée par Piaf, et ici passée au crible d’une interprétation non dénuée d’ironie. Comédienne avant tout, son travail scénique est porté par une gestuelle unique, une mise en scène sobre et passionnée. C’est très beau.
Dans les jours qui vont suivre, le Printemps devrait nous mener vers d’autres expériences, jeunes et confirmées, de Tahiti 80 à Yann Tiersen. Nous vous les raconterons.
Catherine Pouplain