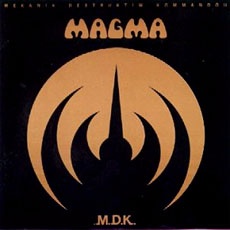Le Magma nouveau

Le plus étrange des groupes français des années 70, Magma, retrouve le chemin des salles. Ayant rassemblé sept musiciens autour de lui, Christian Vander, son créateur, renoue avec une aventure mythique entre frisson grand public et avant-garde. Déjà en 1996, il avait ressuscité cette singulière formation pour quelques concerts au Trianon à Paris (un DVD doit bientôt sortir). Cette fois, cette musique foisonnante, entre rock, jazz et musique contemporaine, descend dans une cave. Le Sunset, club de jazz du quartier des Halles, accueille Magma jusqu'au 9 février.
Voyage inattendu vers Kobaïa
Le plus étrange des groupes français des années 70, Magma, retrouve le chemin des salles. Ayant rassemblé sept musiciens autour de lui, Christian Vander, son créateur, renoue avec une aventure mythique entre frisson grand public et avant-garde. Déjà en 1996, il avait ressuscité cette singulière formation pour quelques concerts au Trianon à Paris (un DVD doit bientôt sortir). Cette fois, cette musique foisonnante, entre rock, jazz et musique contemporaine, descend dans une cave. Le Sunset, club de jazz du quartier des Halles, accueille Magma jusqu'au 9 février.
«Entre musiciens, nous trouvions qu’il ne se passait rien en France. Un jour, j’ai proposé aux meilleurs musiciens de Paris de faire un groupe. Aussitôt, on m’a demandé combien ce serait payé. Alors j’ai fait Magma avec de complets inconnus.» Comme beaucoup d’idées capables de changer une époque, la naissance de Magma, telle que la raconte Christian Vander, a quelque chose d’une confondante simplicité.
En 1969, entre un rock qui parvient à peine à se penser français, et un jazz qui se précipite dans l’idée d’un free sans limite et sans contrainte, Chistian Vander crée un groupe proprement incroyable. Magma va faire le lien entre le vacarme rock, la furie libératrice du jazz de Coltrane et une bonne dose de rêve. Ni rock, ni jazz, ni jazz-rock, situé dans un domaine en friches (un rock-fiction, comme il existe une science-fiction ?), le groupe de Vander va inventer tout à la fois : un logo en forme de griffe circulaire (une démarche qui n’existe pas, alors, dans le show business), des dispositifs techniques assez neufs (à commencer par le premier piano électronique Fender Rhodes en France), une manière singulière de jouer de la musique, entre stricte écriture et improvisation libératrice, et surtout le kobaïen. Cette langue de la planète Kobaïa (une planète du futur, précise Magma, à l’époque) fait passer Christian Vander pour un illuminé et son groupe pour une quasi-secte.
Mais le public suit avec jubilation, fasciné par cette langue à la fois moelleuse et gutturale. «Le kobaïen a été composé parallèlement à la musique, se souvient Christian Vander. Je créais les mélodies au piano et ces sons venaient – je les laissais venir. Il ne fallait pas chercher à faire du kobaïen, le kobaïen venait naturellement. Mais on trouvait aussi des sons anglais dans la musique de Magma. Plus tard, avec Offering (le groupe qui a succédé à Magma dans les années 80), j’ai réussi à improviser en direct en français. Je découvrais les thèmes et je notais les paroles ensuite, sur l’enregistrement.»
Dans les effervescentes années 70, Magma sort disque sur disque, lance tournée sur tournée. «On ne savait même pas ce qu’on était en train de faire. Je me disais qu’il se passait quelque chose dans cette musique, mais je préfère me poser les questions après – la musique devance l’esprit. Il fallait déjà assumer le choc physiquement ! Le plus dur est d’entrer dans la musique et de ne pas en être expulsé.» Et quand Vander parle des exigences physiques de la musique de Magma, il n’exagère pas. Dans Magma, il apparaît comme un monstre aux bras multiples, au jeu de batterie étourdissant. «Ce qui m’a inspiré à ce moment, c’était de voir Elvin Jones jouer avec John Coltrane en étant debout derrière sa batterie. Il plantait des clous sur la scène pour bloquer sa pédale charley et sa pédale de grosse caisse. Quand on avait vu des gens pareils, comment penser à se présenter autrement sur scène ? En France, les gens pouvaient jouer cinq heures sans que la batterie bouge d’un millimètre.»
Bien qu’il demande à ce que son impressionnante batterie hérissée de cymbales ne soit pas trop éclairée, son charisme éclipse presque les autres membres de Magma qui, aujourd’hui, semble avoir été une véritable université de l’audace musicale. En effet, le groupe a vu passer les bassistes Jannik Top et Bernard Paganotti, le pianiste Gérard Bikialo, le violoniste Didier Lockwood, le chanteur Klaus Blasquiz et quelques dizaines d’autres, devenus depuis des sommités du jazz, du rock ou de la variété. Mais, dans la pénombre des concerts de Magma, Vander a aussi imposé une austérité visuelle qui sera beaucoup imitée plus tard : «A l’époque, les gens étaient habillés avec des fleurs, des couleurs, tout un ramdam extérieur tape-à-l’œil. Nous, nous étions sobrement habillés en noir, et surtout silencieux. Je voulais rester dans la concentration, dans le recueillement. Quand on me demandait pourquoi, je répondais que c’était pour éviter de regarder les chaussettes jaunes du bassiste.»
Avec Magma, Offering et sous son propre nom, l’aventure musicale de Christian Vander se décline en une quarantaine d’albums, dont quelques monuments, comme Mekanïk Destruktïw Kommandoh ou Köhntarkosz. C’est justement entre ces deux disques que les concerts de ce nouveau Magma entendent se situer, avec KA 1.2.3, une pièce inédite d’une quarantaine de minutes que Christian Vander avait laissée inachevée il y a presque trente ans et qu’il a récemment reprise et achevée. Un nouveau voyage, peut-être un peu nostalgique, vers Kobaïa.
Magma au Sunset, jusqu'au 9 février.