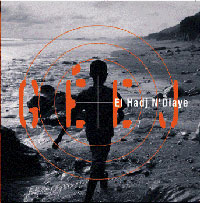El Hadj N’Diaye prend la mer

Distingué par l’Académie Charles-Cros pour son précédent album paru en 2001, le Sénégalais El Hadj N’Diaye mise davantage sur sa voix profonde et sur les mots que sur le rythme. A travers son troisième album Géej, “la mer” en wolof, le chanteur guitariste veut d’abord relayer les préoccupations de ses compatriotes.
Géej, chronique sociétale du Sénégal
Distingué par l’Académie Charles-Cros pour son précédent album paru en 2001, le Sénégalais El Hadj N’Diaye mise davantage sur sa voix profonde et sur les mots que sur le rythme. A travers son troisième album Géej, “la mer” en wolof, le chanteur guitariste veut d’abord relayer les préoccupations de ses compatriotes.
RFI Musique : Vos sources d’inspiration sont très concrètes : le naufrage du Joola, l’émigration clandestine par la mer, le quotidien des vendeurs de rue… Vous avez besoin de cet ancrage dans la réalité pour vos textes ?
El Hadj N’Diaye : Pour moi, le chanteur a un rôle à jouer dans la société : parler de ces choses que vivent des milliers de gens qui n’ont pas la possibilité de les exprimer. On est en quelque sorte la voix du peuple. Quand j’ai commencé, c’était extrêmement difficile. Nous n’avons pas de tradition de chansons à message au Sénégal. En principe, si tu n’étais pas griot, tu ne devais pas chanter. Mais j’ai voulu faire des chansons à thèmes, pas laudatives contrairement à ce qui se faisait, et c’était nouveau. Depuis, avec la mouvance rap, les jeunes se sont mis à parler de plus en plus de faits de société.
Ecrire une chanson, est-ce un exercice qui vous demande du temps ?
Il y a une manière d’exprimer, de faire ressentir à l’autre ce que l’on voit, ce qui nous touche. Il arrive que je passe plusieurs jours pour faire une chanson, mais la plupart naissent d’un trait. Parce que ce sont des choses vécues, qui murissent dans l’esprit et sortent d’un coup. Gueej, par exemple, parle de ces milliers de jeunes Sénégalais qui ont conscience qu’ils risquent leurs vies en montant sur des embarcations pour aller en Europe. Cette chanson est née à Paris mais ses fondements, je les ai emmagasinés au Sénégal. C’est une réalité de tous les jours que l’on côtoie.
Vous vivez au Sénégal, mais avez-vous déjà eu la tentation de vous expatrier ?
Ça m’est arrivé dans les années 90. J’ai eu une opportunité pour aller au Canada mais je n’y suis pas resté plus de six mois parce que j’ai réalisé que ma voie n’était pas là. Autant revenir chez moi, dans mon quartier de Thiaroye et montrer qu’il y est possible de faire des choses. Même si je gagne peu, je sais que c’est mieux. Mais quand j’en discute avec les jeunes, que je leur dis qu’ils ne vont pas trouver en Occident l’Eldorado dont ils rêvent, ils me répondent que je peux toujours parler !
Qu’est-ce qui vous a amené à jouer de la guitare et prendre le micro ?
Quand j’ai eu le baccalauréat, mon frère qui étudiait en Union soviétique m’a envoyé une guitare. J’ai commencé à gratter les cordes. Ça s’est imposé à moi : ce que j’avais à dire, je pouvais le poser sur des notes de musique, simples, qui me donnaient les moyens de transmettre mes sensations, les thèmes que je voulais développer. Quand on était assis en groupe, j’aimais bien chanter. Ce sont mes amis qui m’ont poussé à aller présenter mes morceaux dans une émission de radio, au milieu des années 80. Chaque semaine, je venais avec une nouvelle chanson.
Quelle a été votre démarche, votre envie pour ce troisième album international ?
Le premier album avait été enregistré en trois jours avec deux guitares, des percus. Le deuxième a été mieux orchestré. Le troisième album apparaît comme une synthèse, mais ce sont toujours les messages – et la voix qui les transmet – auxquels j’attache le plus d’importance. C’était un travail beaucoup plus long. Une plus grande réflexion. Depuis l’alternance politique au Sénégal, je n’avais sorti aucun album. Beaucoup d’événements se sont passés et il fallait vraiment en parler. Je n’ai jamais été aussi précis, avec l’envie de dire et de présenter les choses exactement comme elles sont. Même si elles peuvent être parfois perçues brutalement. Musicalement, j’essaie de voir ce qui s’adapte le mieux à ce que je fais. Dans cet album, pour la première fois, j’ai joué avec un violoncelle. La musique gagne toujours à s’ouvrir, à tenter des expériences nouvelles.
… Comme Tokoroni, cette chanson en japonais qui figure sur votre nouveau disque ?
Absolument. Je l’avais composé pour participer à un sommet au Japon. Je n’y suis pas allé mais j’ai toujours gardé en tête l’idée de sortir un jour ce morceau. Je me suis beaucoup amusé dans le passé à traduire certaines chansons dans d’autres langues : en danois, en allemand, en vietnamien. C’est peut-être une manière d’approcher l’autre par sa langue. Cette chanson avait été traduite par le représentant de la coopération culturelle japonaise à Dakar qui m’avait donné la phonétique. Ça m’avait demandé beaucoup d’énergie et de travail pour la prononciation. Je l’ai chantée pour la première fois lors de mon premier voyage à Paris où j’étais invité à la préparation du sommet de Rio qui s’était faite à La Villette. J’ai débarqué avec ma guitare dans un atelier de Japonais, j’ai chanté, et ils ont tous compris !
Ecoutez un extrait de
El Hadj N’Diaye (Marabi/Harmonia Mundi) 2008