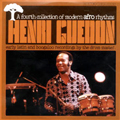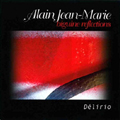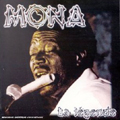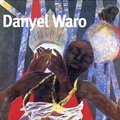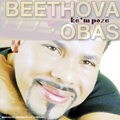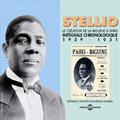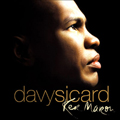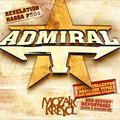Dix artistes emblématiques

De l’océan Indien à la mer des Caraïbes, la sphère créole "francophone" a engendré une multitude de créations en tout genre, toutes marquées par ce goût de l’échange immanent et du mélange permanent. En voici une sélection, forcément limitée, de dix artistes emblématiques.
La vaste scène créole
De l’océan Indien à la mer des Caraïbes, la sphère créole "francophone" a engendré une multitude de créations en tout genre, toutes marquées par ce goût de l’échange immanent et du mélange permanent. En voici une sélection, forcément limitée, de dix artistes emblématiques.
Kassav
En choisissant le nom de la traditionnelle galette de manioc, le groupe enracine son propos dans le riche terroir guadeloupéen. C’est l’un des enjeux de Pierre-Edouard Décimus, pilier de la scène locale, lorsqu’il fonde en 1979 les bases du groupe avec Freddy Marshall : concocter leur propre sauce à partir des mêmes ingrédients. Ce sera le zouk, cette rythmique collé-serré qui va très vite décoller et s’imposer dans l’archipel caribéen. Kassav sera la matrice du son antillais des années 80, avec Malavoi, le groupe-phare de la Martinique né dix ans plus tôt en 1969 sous la direction de Mano Césaire, avant de fixer sa formule au tournant des années 80, avec Paulo Rosine et Ralph Tamar.
Kassav Lagé Mwen (Celluloïd)
Henri Guédon
"On a perdu du temps à vouloir séduire la métropole, au point d’être regardés comme des curiosités exotiques. Il faut dépasser le malaise récurent d’intégration", telle était l’ambition du musicien-plasticien Henri Guédon, né à Fort-de-France le 22 mai 1944, jour anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Tout un symbole pour ce fan de Dizzy Gillespie qui va inoculer le son du barrio new-yorkais aux Antilles. A la tête d’orchestres à géométrie et géographie variables, aux sonorités toutes tropicales, Henri Guédon sera même le géniteur du mot zouk avec l’ambitieux album CosmoZouk. Parmi tous les francs-tireurs qui l’ont accompagné, mention toute spéciale à un autre aventurier des notes bigarrées : le pianiste Marius Cultier.
Henri Guédon Early Latin and Boogaloo Recordings by the drum master (Comet Records)
Alain Jean-Marie
Avant de devenir le maître du piano jazz, il aura œuvré dans les coulisses de la renommée à Pointe-à-Pitre, sa ville natale en 1945, accompagnant entre autres les premiers pas de Malavoi. Alain Jean-Marie cherchait déjà la note bleue dans les mélodies créoles. "Les musiciens de la Nouvelle-Orléans qu’on appelait les créoles ont des phrasés qui rappellent les clarinettistes antillais. Il y a des liens naturels entre nous." Ce fut d’ailleurs la thématique de son premier disque, en 1968, chez Debs. Piano Biguine, en trio. Il y reviendra un quart de siècle plus tard avec des Biguine réflections où le bop brille en se reflétant dans la biguine. Un art majuscule qu’il conjugue aujourd’hui en duo avec son cadet et héritier, le Martiniquais Mario Canonge.
Alain Jean-Marie Delirio (Couleurs Music)
Eugène Mona
Dès les premières notes de Bois brilé, en 1973, l’affaire est entendue : Eugène Mona est un artiste d’exception. Natif du Vauclin, en Martinique, ce chanteur et flûtiste deviendra l’un des porte-voix pour les musiques-racines, bwa-bwa et bélé. L’auteur de l’incroyable Roi Ni go porte en lui toutes les valeurs apprises auprès d’aînés, dont le flûtiste des mornes Max Cilla, qu’ils réforment en les mélangeant à une orchestration "moderne". Le tout avec des paroles tout en métaphores où ce "Nègre debout" appelle à la conscience de son peuple et à la défense de l’identité créole. Eugène Mona décèdera en pleine rue, en 1991, tout comme le percussionniste guadeloupéen Marcel Lollia, chantre de l’identité gwo-ka plus connu sous le sobriquet de Vélo, termina sa vie en 1984 dans le caniveau. Les deux sont depuis entrés dans la légende…
Eugène Mona La Légende (Hibiscus)
Danyel Waro
"Le petit Blanc des hauts" a réussi à imposer sa marque de fabrique dans l’univers de la musique traditionnelle réunionnaise. Ce n’est pourtant qu’en 1994, à près de quarante ans, que ce poète publie son premier disque. Le suivant, Foutan Fonnker, pose définitivement ce militant de la créolité comme l’un des plus sûrs gardiens du maloya, ce blues créole de l’océan Indien dont il eut la révélation en écoutant Firmin Viry, patriarche d’une famille de musiciens. Danyel Waro en renouvelle la formule, y apportant son écriture poétique et politique, qui ne manque pas de faire songer à celle d’un autre maître à jouer réunionnais : Alain Péters, auquel il a rendu un vibrant hommage posthume.
Danyel Waro Foutan Fonnker (Cobalt)
Beethova Obas
Une voix douce-amère, des textes faits de colère sur fond de misère, Beethova Obas pétrit son écriture du calvaire qu’endure son pays, Haïti. Il faut dire que son père, peintre engagé, disparut durant le règne des tontons Macoute. Lui s’inscrit donc tout naturellement dans le courant contestataire "rasin" de Manno Charlemagne. Révélé en 1988 par RFI, ce guitariste gaucher qui chante dans un créole châtié devient la coqueluche de la chanson engagée haïtienne, tournant à travers la planète avant de se montrer plus discret. Malgré tout, avec sa guitare toute en sensualité chaloupée, Beethova Obas demeure le meilleur des troubadours haïtiens comme le démontre encore en 2000 sa présence dans Haïtian Troubadours. C’est encore lui que cite comme "modèle" Bélo, qui représente la relève en chantier et enchantée d’Haïti.
Beethova Obas Kè’m Poze (Aztec Musique)
Stellio
Aux Antilles françaises, il y eut Félix Valvert, le roi de la rumba, Albert Lirvat, l’inventeur du wabap, ou encore Robert Mavounzy, le saxophoniste fort en thèmes… Mais Alexandre Stellio, le dynamiteur de la biguine, tient une place à part dans ce panthéon créole, une scène qu’il dominera pendant l’âge d’or des années 30. Nul doute que ce clarinettiste et compositeur martiniquais aura porté au plus haut le swing caraïbe, en des variations qui tutoient les improvisations de la Nouvelle Orléans. Pour s’en convaincre, il faut réécouter tous ses classiques, l’agile Serpent Maigre ou le subtil Paris Biguine, des monuments qu’il colore de sa sonorité lyrique et de son inventivité mélodique. A sa mort, en juillet 1939, il laisse un riche patrimoine que les cadets ne cessent depuis de réinvestir.
Stellio Intégrale chronologique (Frémeaux&Associés)
Tabou Combo
La légende prétend que c’est en fusionnant la rythmique du Pont de la rivière Kwaï et celle de l’ancien meringue haïtien que le saxophoniste Nemours Jean-Baptiste aurait fait la découverte de la musique de danse populaire, susceptible de fédérer la jeunesse d’Haïti. Le kompa-direct est né, bientôt électrisé par la scène émergente au tournant des années 70. Emblématique de cette déferlante qui va arroser toutes les Caraïbes, Tabou Combo s’impose comme les ambassadeurs de ce style qui mixe les cadences du meringue, les transes hypnotiques de la musique rara, les contredanses modernisées ou encore les influences de soul et de funk. Un brouet en fusion qui invite sur la piste de danse et rappelle qu’Haïti est avec Cuba le sanctuaire des rythmiques afro… Celles qui seront aussi la base d’un autre groupe au cocktail explosif : Boukman Esperyans, qui électrisent la musique "rasin".
Tabou Combo Taboulogy (Aztec Musique)
Davy Sicard
A la suite de la lame de fond du renouveau identitaire réunionnais, inspiré par le rural maloya, toute une génération va s’exprimer en croisant ces rythmiques ternaires à d’autres musiques, fécondant un style original. Davy Sicard en trace ainsi des contours inédits, dans une veine néo-folk aux teintes bleu nuit, avec sa guitare acoustique, mais aussi le gros tambour. Son "maloya kabosé" évoque certaines aventures sonores d’un aîné, le touche-à-tout René Lacaille, mais aussi l’ouverture d’esprit revendiquée par la chanteuse Nathalie Natiembé ou encore les innovations de Christine Salem qui fertilisent ses racines aux créations de la diaspora africaine… Si tous puisent aux sources communes, chacun en propose de singulières perspectives, essaimant et ensemençant leur terroir créole sur d’autres champs d’investigation.
Davy Sicard Ker Maron (up music)
Admiral T
Dès 2002, l’enfant du ghetto de Boissard affirmait haut et fort son originalité dans le paysage du dance-hall caribéen, avec un phrasé inspiré des rythmiques ka. Gwadada, un titre où il dépeint le malaise guadeloupéen, ne manquera pas de faire tressauter le public de Kingstown. Depuis, ce toaster superstar est devenu l’icône d’une jeunesse Nèg Marron, pour reprendre le titre d’un film où il figure. Nul doute qu’Admiral T aura montré la voie à suivre pour toute une génération. Comme dit Star Jee, un des pionniers du hip hop de Pointe-à-Pitre. "Le devenir du hip hop et du dance-hall guadeloupéen, c’est le ka. Sinon, on restera des copies tropicalisées des Etats-Unis !” C’est d’ailleurs sur le même sillon que s’inscrit le Guyanais Prince Koloni, qui revisite l’aléké, la bande-son de ses origines bushinengue, à l’aulne du reggae digital.
Admiral T Mozaïk Kreyol (Universal)