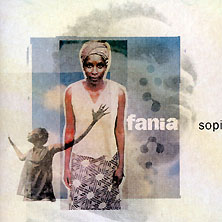LE NOUVEAU SON SÉNÉGALAIS

Paris, le 13 décembre 2000 - Voici les nouveaux venus de la musique sénégalaise, Tukuleur et Fania. Sur les traces de leurs grands frères africains, ils ont su aussi intégrer les courants musicaux occidentaux.
Tukuleur et Fania
Paris, le 13 décembre 2000 - Voici les nouveaux venus de la musique sénégalaise, Tukuleur et Fania. Sur les traces de leurs grands frères africains, ils ont su aussi intégrer les courants musicaux occidentaux.
TUKULEUR : tchatche toute en couleurs
Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Un album mélodique tressé de rap solaire et dansant, avec des textes qui font largement référence à l'Afrique. L'objet musical en question s'appelle Njibinaami. Les deux rêveurs ont pour nom Oumar et Moussa Sall. Ils forment le tandem Tukuleur.
"Rien n'arrête l'appel des racines, surtout quand il est fort". Cette phrase, glissée dans le titre Afrika qui ouvre l'album, résume à elle seule le sens de leur démarche. Ils sont nés et ont grandi à Montargis, en France certes, mais ils ont toujours gardé un lien avec le Sénégal qu'ont quitté un jour, leurs parents. "N'oublie jamais d'où tu viens" enseigne la sagesse populaire. Message bien reçu.
Oumar "Baru" et Moussa Sall ne négligent rien de la culture qui leur a été transmise, la culture peule. Ils s'en sont imprégnés durant toute leur enfance. Il y a en eu des fêtes, des réjouissances communautaires ! Ils n'en rataient pas une. Leur père, d'origine toucouleur, les amenait toujours avec lui. Petit à petit les rythmes, les chants de là-bas, de leur pays éloigné, s'incrustaient en eux. Baaba Maal, "la" voix des toucouleurs participait à cette imprégnation. Ses cassettes passaient en boucle à la maison. Ce qui devait arriver arriva. Oumar et Moussa, bien que férus de hip hop, ont senti monter en eux l'irrépressible envie d'être acteurs de leur culture et pas seulement témoins. D'où l'idée de Tukuleur.
Sans renoncer au rap, mais avec des phrases en langue peule au milieu d'autres en français, des références instrumentales et mélodiques à la terre de leurs ancêtres. Le temps de motiver une maison de disques, de battre le rappel de quelques musiciens (dont le clavier Loy Ehrlich, qui a convoqué Steve Shehan et Didier Malherbe, ses amis du trio Hadouk), et voici venir la carte de visite qui va permettre à Tukuleur de se présenter sous un jour très favorable : un album aux lignes limpides, où hip-hop et mélodies vocales alternent et se répondent, avec des mots qui ont du sens. Est-ce du rap, de la chanson française, de la musique africaine ? Qu'importe l'étiquette, il suffit d'écouter et de se laisser bouger.
Patrick Labesse
Tukuleur Njibinaami Une Musique 2000
FANIA : nouveau fanion de la pop-électro africaine
Fania a passé la moitié de sa vie en Afrique et l'autre en Occident. Née dans la campagne sénégalaise, elle est partie à 17 ans pour Paris. C'est là qu'elle commence à défiler pour les plus grands couturiers Français, et connaît un premier succès musical avec le groupe Kaoma (à l'origine de la Lambada). Après un séjour aux Etats-Unis, Fania est de retour en France pour signer un premier album solo émouvant, qui flirte entre héritage africain affirmé et saveurs électroniques revendiquées. Bonus : un duo avec Horace Andy en forme de tube potentiel.
" Sopi " (le changement en wolof) est devenu le slogan sénégalais de l'an 2000. Utilisé par le nouveau président Wade en campagne, Sopi est aussi le titre d'un album qui prouve encore que Youssou N'Dour a de talentueux compatriotes. Cette fois, cette certitude se conjugue féminin et s'appelle Fania. Si cette jeune artiste prône une mutation, c'est que durant toute sa vie, elle les a accumulées.
Elevée au son des sourates du coran psalmodiées par son grand-père, et bercée par les pastorales soninké de sa mère, Fania découvre le son international au travers de la musique latino qu'écoutent ses oncles. Puis, elle quitte son petit village de Koungheul (à 400 Km de Dakar) pour Saint Louis et le funk, la pop et le reggae. Arrivée en France peu avant sa majorité, elle travaille avec Toure Kunda et Ray Lema, puis intègre Kaoma, avec qui elle propage la Lambada aux quatre coins du globe. " J'ai beaucoup voyagé, séjourné dans les plus grands palaces. Je ne vivrais jamais cela dans ma carrière en solo ! Je comprends que beaucoup de gens rêvent de ce genre d'aventure " confie-t-elle.
Mais, le succès a aussi un prix : les concessions et la pression. Pour pouvoir quitter le groupe, la jeune fille filiforme est obligée de partir à Los Angeles. Là, en quatre ans, elle découvre le son américain et frotte sa corde sensible à divers univers musicaux (rap, jazz, rock ou funk). De ces différentes évolutions, Fania garde plusieurs identités : un mélange de fragilité et de puissance, d'Afrique et d'Occident, d'engagement et de modestie. Plutôt réservée sur scène, elle peut se laisser porter par une danse endiablée et entraîner le public.
Sa musique est aussi le témoin de toutes ces expériences. Malgré les samples et certains beats électroniques (signés par Sie Medway, collaborateur d'Howie B, de Björk ou de U2), une ambiance africaine émane de cet album. Kora, guitares, xalam, et diverses percussions (notamment le fougueux tama, un tambour d'aisselle) ne sont jamais étouffées par le traitement de son des années 2000. Dans ses ballades, Fania renoue aussi avec ses racines en chantant exclusivement dans les différentes langues de son pays (wolof, peulh, sarakholé, mandingue) qu'elle parle toutes. "Je suis métisse. Ma mère est sarakholé, mais originaire du Mali. Mon père est peulh, et je suis née au Sénégal, donc obligée de parler wolof et français " s'excuse-t-elle presque. La seule introduction de l'anglais vient du timbre magique du Jamaïcain Horace Andy (la voix de Massive Attack). La star du reggae signe un duo inspiré, où les racines africaines épousent une fois encore pour le meilleur l'arbre de la famille rasta. Un changement de cap bien négocié.
Elodie Maillot
Fania Sopi Globe/Sony 2000