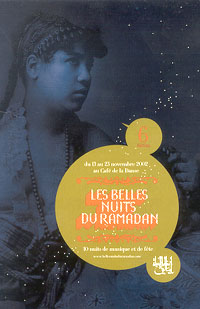LES BELLES NUITS DU RAMADAN

Loïc Barrouk et son équipe entraînent pour la sixième année Paris dans l’imaginaire éclaté du monde arabo-musulman. Dix soirées au Café de la Danse, rondement orchestrées en musiques orientales et affiliées. Nass El Ghiwane s'y produira lundi soir. Une occasion inespérée de redécouvrir le groupe culte du Maghreb des années 70.
Nass El Ghiwane et les autres<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Loïc Barrouk et son équipe entraînent pour la sixième année Paris dans l’imaginaire éclaté du monde arabo-musulman. Dix soirées au Café de la Danse, rondement orchestrées en musiques orientales et affiliées. Nass El Ghiwane s'y produira lundi soir. Une occasion inespérée de redécouvrir le groupe culte du Maghreb des années 70.
Les Rolling Stones marocains ?
Il paraît que le réalisateur américain Martin Scorsese fut tellement séduit par leur groove, qu’il les considérait comme les Rolling Stones marocains. Comparaison inappropriée sans doute pour tout puriste de l’époque actuelle mais qui contribue à alimenter la légende d’un des groupes les plus inspirés de sa génération. Fondé en 1963 à Casablanca par Omar Sayed, Boudjemîî et Larbi Batma, Nass El Ghiwane inventa un son maghrébin, résolument contemporain, qui balaya au passage les mièvreries portées par la chanson âsriya, chanson d’amour venue tout droit du Caire pour enflammer les cœurs de leur terre d’origine. Nass El Ghiwane, avec ses textes militants, saura sublimer le populaire, sans succomber aux sirènes de l’imitation servile. Les Marocains commenceront par ancrer leur musique dans des traditions qui leur paraîtront plus proches de leur vécu. Ils dénonceront l’oppression et la corruption dans leurs textes et sauront assez vite camper les frustrations «des plus petits».
Transe mélodique et vibrations rythmiques, leur son marie gnâwi et 'arûbi, s’inspire de la hadhra et du hâl, autant de références musicales puisées dans le patrimoine national séculaire, auxquels ils enjoignent une parole engageante et engagée sur des problèmes de société et de politique. Musique foncièrement proche du peuple mais qui se refuse à toute facilité. Mariage de sonorités et d’instruments inédits (du bendir au tbila, en passant par le banjo ou la mandoline) qui invitent à la découverte d’une culture forte, qui promène l’oreille du profane au sacré sans crier gare. Chants confrériques, répertoires urbains ou paysans… les cinq «fous furieux» du Nass El Ghiwane jouent à se souvenir du passé, tout en conviant leur public, de cœur (maghrébin) ou de raison (celui plus large des mélomanes de tous pays), dans un champ sonore expérimental, voire avant-gardiste par certains côtés. On ne compte plus le nombre de groupes qui se sont précipités sur leurs pas, surtout dans les années 80. Souvent annoncé pour mort par ses détracteurs, plus d’une fois menacé de dislocations (à la mort entre autres de Boudjemîî en 74), le groupe continue encore à surprendre de nos jours, avec la même ferveur qu’au départ, bien qu’il n’y ait plus que deux vétérans de la première formation dans ses rangs. Nass El Ghiwane demeure fidèle à sa légende. Démonstration lundi soir au Café de la Danse. Pour le bon plaisir du public des Belles Nuits du ramadan
Après ce come-back parisien des Ghiwane marocains, se tiendront encore cinq autres Nuits du ramadan dans l’ambiance feutrée du Café de la Danse. Auparavant, le public aura pu saluer des talents aussi consacrés que ceux de l’azerbaïdjanais Alim Qasimov et de l’Ethiopien Mahmoud Ahmed, qui se sont partagés les quatre premières nuits.
Mais foin de regret pour ceux qui n’ont pas eu l’immense plaisir de les applaudir ou de les découvrir, la suite du programme ne manque pas de piquant. Ainsi, le soir du 19 novembre, rayonnera l’étoile des Rozaneh. En perse, ce mot signifie lumière et espoir à la fois. Tenu à portée de voix par Parvin Javdan et Zohreh Bayat, cet ensemble de femmes se revendique d’une grande poétique mystique d’obédience soufie, dont le verbe s’enracine cependant dans une réalité des plus contemporaines. Chants habités, chants de douceur pleine, en provenance d’un pays où la femme subit contraintes sur contraintes sous couvert d’interdits religieux.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mercredi 20 novembre résonnera le timbre du Sheik Ahmed Al Tuni. Turban blanc et sipa (chapelet) à la main, l’oiseau soufi, touché par la grâce divine, évoquera avec volupté le souffle des prophètes en quête d’illumination. A peine a-t-on entendu les premiers vers dévaler son palais il y a trois ans sur la scène du Théâtre de la Ville, à Paris, que les mélomanes les plus avertis se sont donnés rendez-vous aussitôt dans les bacs. A la recherche d’un album certes peu médiatisé mais ô combien incontournable (Le sultan de tous les Munshidin, paru chez Long Distance/ Wagram).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Âgé de 70 ans, Sheik Ahmed Al Tuni, que l’on a vu récemment dans Vengo, le film de Tony Gatlif, nous vient de Haute Egypte. Un seul mot résume son génie: l’émotion, pleine et pure. Le lendemain, suivant son passage au Café de la Danse, l’ensemble Kaboul laissera Ustad Mawash mener la danse. L’ensemble afghan invite le mélomane aux quatre coins de l’Orient. Classique et populaire. Religieux et poétique. Le temps de souffler… Et à nouveau le Maghreb sera à l’affiche. Avec Iness Mêzel le 22 et une soirée Chaâbi algérois le 23 novembre. Pour la petite histoire, Iness Mêzel est une reine kabyle au timbre rare, qui pratique avec gourmandise un échangisme musical de bonne vie. En 98, elle remportait les Kora Awards comme meilleure chanteuse d'Afrique et meilleur artiste d'Afrique du nord. Quant à la grande histoire du chaâbi, elle nous ramène dans les rues de la casbah d’Alger, où se chuchotent encore les amours arabo-andalouses sur des notes qui datent du début du 20ème siècle. Notes grâce auxquelles se sont illustrées des voix aussi fameuses que celles de Dhamane El Harrachi (que Rachid Taha avait récemment repris avec le tube Ya rayah).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Une belle aventure<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nuits du ramadan, nuits de l’échange. A force, la France finira bien par s’y laisser prendre dans son ensemble. Du moins, le souhaite-t-on pour Loïc Barrouk, principal initiateur de ces nuits atypiques, qui ont déjà conquis six autres villes françaises (Noisy le Sec, Evreux, Nantes, Le Mans, La Rochelle, Belfort) pour cette seule année 2002. Sans oublier Bruxelles, qui compte deux soirées à son programme. Crise de parano aidante, certains auraient facilement parié sur une remise en question de ces nuits depuis la fameuse douleur du 11 septembre 2001. Qui ne se souvient pas du bide de Latitudes Villette/Maghreb? Evénement parisien pourtant d’envergure, ce rendez-vous organisé en juin dernier, a laissé croire, malgré une belle programmation, que l’image des musulmans de France pouvait jouer contre la traditionnelle convivialité du monde du spectacle. Résultat : peu d’affluence.
Un membre du staff de la Cité de la Musique, où se tenait ce festival, déclarait sur fond de déception : «Il faudra analyser ce bide. Peut-être que les Maghrébins ne sont pas venus en nombre, à cause du 21 avril (ndlr : premier tour des élections présidentielles en France). Pour montrer qu’ils sont contre la lepénisation actuelle des esprits. Peut-être que le public non-communautaire, lui, n’est pas venu à cause du 11 septembre. On a tendance à rejeter tout ce qui est connoté arabe depuis Ben Laden».<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Loïc Barrouk semble, lui, conscient de cette déroute éventuelle, lorsqu’il salue le succès de «ses» Nuits depuis six ans, en se référant notamment à l’actualité chaude et ingrate: «une situation malheureusement de plus en plus dramatique au Proche-Orient, [des] événements innommables aux Etats-Unis et [de] récentes alertes électorales extrémistes en France. Cela fait autant d’excellentes raisons de persévérer et de croire au bien-fondé de cette manifestation». Pour lui, le ramadan, contre toute image caricaturale, représente un prétexte à «la rencontre des communautés, à la tolérance, au dialogue, à la découverte de l’autre». Cela tient de la conviction première. Et le public a l’air d’apprécier, tout comme les nombreux partenaires et médias qui soutiennent l’événement. L’aventure se déroule désormais comme un conte de fée. Ce qui finit par lui faire croire que participer aux «Belles Nuits du ramadan, n’est pas un acte anodin». D’où ces multiples et interminables remerciements envers tous ceux qui contribuent à rendre magique son concept. Pourvu que ça dure…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />