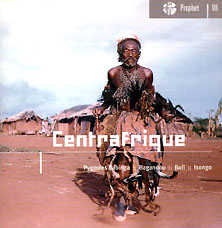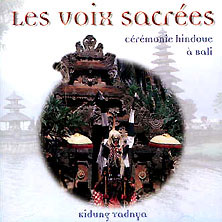RITUELS EN SCÈNE

Paris, le 6 juin 2001 - Besoin de spiritualité, d’authenticité — goût pour l’exotisme et mode ethnique — les rituels et le sacré envahissent les scènes occidentales. La mise en scène de spectacles d’essence rituelle ou religieuse va-t-elle de soi ? Revue de quelques questions qu’on ne peut éviter de se poser.
Ou la place du sacré dans les musiques du monde.
Paris, le 6 juin 2001 - Besoin de spiritualité, d’authenticité — goût pour l’exotisme et mode ethnique — les rituels et le sacré envahissent les scènes occidentales. La mise en scène de spectacles d’essence rituelle ou religieuse va-t-elle de soi ? Revue de quelques questions qu’on ne peut éviter de se poser.
La grâce de Bach ou d’Amir Khusrau
La présence des musiques sacrées ou rituelles sur les scènes occidentales n’est pas un phénomène récent, mais depuis une quinzaine d’années elle s’est considérablement accrue dans le sillage de la world music, ce qui change certaines données du problème. Quand le flûtiste soufi Kudsi Erguner venait à Paris ou à Londres avec des derviches turcs en 1970, il se produisait pour une poignée d’amateurs ou bien devant les adeptes très avertis du philosophe mystique Gurdjieff. On mesure la distance parcourue en songeant à l’extraordinaire succès du qawwali pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan et aux expériences musicales parfois douteuses auxquelles il s’est prêté.
Les questions posées par la représentation de spectacles (le terme est très approximatif) sacrés ou de rituels extra-occidentaux en Europe sont multiples. Mais on pourrait n’en retenir que deux, à l’esprit de tout producteur de spectacles qui se respecte : celle du contexte (comment passer du village à la scène ?) et celle du savoir culturel partagé (qui sont ces gens ?). Pourtant, elles ne se posent pas avec la même acuité pour tous les types de spectacles.
Les arts « classiques », présentés régulièrement et depuis longtemps sur les scènes de leur pays d’origine — du Maroc à Java, d’Iran au Japon — ne soulèvent pas de difficulté. Néanmoins, lorsqu’un chanteur d’Inde du Sud explique en concert à Paris que la beauté de ses chants dévotionnels tient à leur caractère divin, ça ricane au troisième rang : on comprend que tous ne sont pas sur la même longueur d’onde. Les musiques sacrées en Europe sont si complètement détachées de leur fonction liturgique première, que l'idée ne viendrait à personne de se laisser toucher par la Grâce pendant une Messe en Si, et la même opération est à l’œuvre pour tout ce que l’Occident importe de l’extérieur.
C’est pour cela que les arts «populaires», au contenu artistique moins fort et plus étroitement liés au contexte où ils évoluent, peuvent se révéler délicats à manier. Cela est encore plus vrai des musiques et des danses fonctionnelles (chants de travail, de deuil, berceuses, etc.), parmi lesquelles les rituels forment un sous-ensemble particulier. Ici, le qawwali pakistanais constitue un cas intermédiaire. En effet, il s’agit d’une tradition populaire et d’un rituel mystique, qui s’est partiellement détaché de son contexte depuis qu’on l’a élevé au rang de genre national pakistanais ; en somme, après 1947 les poèmes d’Amir Khusrau ne sont plus réservés aux soufis d’Inde et du Pakistan. C’est cela et le génie de Nusrat, sa souplesse, qui ont fait du qawwali un des emblèmes de la world music à partir de 1985.
Représenter les rituels
En matière de rituel, a priori il n’y a pas de solution. Certains diront qu’extraire une musique ou une danse de son contexte quel qu’il soit, c’est la corrompre un peu, c’est-à-dire complètement. A plus forte raison un rituel, même profane, qui devient pur spectacle livré au jugement esthétique d’un spectateur étranger. Mais à la décharge de ceux qui participent de près ou de loin à cette… mascarade (?), artistes, producteurs, ethno(musico)logues, spectateurs, il faut reconnaître que les « artistes », eux, ne s’y trompent pas. Lamas tibétains ou Gbayas de Centrafrique, ils savent que la représentation sur scène d’un rituel ne vaut pas pour son exécution in situ, et sont capables de la distance nécessaire pour s’adapter aux conditions du spectacle.
Françoise Gründ que l’activité à la tête de la Maison des Cultures du Monde a souvent placée face à des situations délicates, rapporte comment des Bataks de Sumatra ou des Bamoums du Cameroun ont su adapter des rituels qu’il n’était pas possible de reproduire à l’identique, parce qu’ils exigeaient la présence d’une personnalité absente, ou parce qu’il aurait fallu faire un sacrifice sanglant sur scène. L’essentiel est de conserver sa valeur artistique à l’objet représenté et d’échapper à deux écueils : la folklorisation — réécriture fade et perverse — et l’exclusion du spectateur — qui lui donne le sentiment pénible de faire du voyeurisme.
Certes. Encore cela suppose-t-il que ces rituels ont une valeur artistique — pour nous ? Pour les exécutants ? —, qu’il est possible (et licite) de les exécuter dans ce but unique, et qu’on peut encore les offrir à des spectateurs qui ne sauront en apprécier que l’aspect formel. Qui n’a entendu au sortir d’un « spectacle » une réflexion du genre : «En tout cas les costumes sont superbes…» ? Cet en tout cas dévoile cruellement la distance abyssale qui sépare l’avant-scène des premiers rangs de l’orchestre. Aucune brochure ne donne toutes les clefs de compréhension d’un univers à peine esquissé sur scène, même les producteurs n’y comprennent pas toujours grand-chose et, au fond, seuls les artistes et les « experts » présents (ethno(musico)logues) s’y retrouvent.
Faut-il montrer ? Que faut-il montrer ? Il n’y a pas de réponse absolue et, en tout état de cause, la voie est étroite. A cet effet, il ne serait pas inutile de nous retourner la question : qu’accepterions-nous de donner à voir de nos rituels ? Va-t-on assister en spectateur à une messe, fût-elle pascale ? Que dirait-on si « nos » églises s’emplissaient de touristes asiatiques (au hasard), curieux de rituels exotiques ? Quel prêtre monterait sur la scène d’un théâtre de Rangoon (toujours au hasard) et couperait un bout de sa messe pour la rendre accessible à un public… profane ? Chaque culture soulève des problèmes spécifiques et peut apporter ses propres solutions ; voici, à titre d’exemple, le point de vue balinais (Indonésie).
Les danses « sacrées » à Bali
Dans cette île, traditionnellement la danse est à la fois un rituel et un spectacle, offert aux dieux autant qu’aux humains. Mais depuis les années 1920, l’essor du tourisme a multiplié les spectacles destinés aux seuls humains, en l’occurrence des touristes occidentaux. Au début de l’explosion touristique il y a une trentaine d’années, les autorités balinaises s’inquiétèrent de cet état de fait et décidèrent de réglementer la danse. On convoqua à cet effet, un aréopage de spécialistes locaux, chargés de dire ce qui pouvait faire l’objet de représentations commerciales (et donc d’adaptations) et ce qui n’appartenait qu’au religieux.
Mais la langue balinaise ignore les catégories de « sacré » et de « profane », et nos spécialistes furent incapables de les dénommer autrement que par des emprunts (sakral, profan). Finalement, ils établirent l’existence de trois catégories de danses : les danses dites « sacrées », indispensables aux cérémonies ; les danses dites « cérémonielles », qui peuvent accompagner les cérémonies ; les danses dites « séculières », indépendantes des cérémonies. La décision des autorités, ambiguë, fut d’interdire la représentation commerciale des premières, de l’autoriser pour les dernières et d’en laisser ouverte la possibilité pour les secondes… Conclusions inévitablement bâtardes, puisqu’il avait fallu chausser les lunettes de l’Occident pour redéfinir des concepts autochtones.
Au surplus, l’application de ces principes nouveaux restait très aléatoire. D’abord, la coutume varie d’un village à l’autre et toutes les communautés ne s’accordent pas sur le caractère « sacré » d’une danse. Ensuite, afin de répondre à la demande touristique, les artistes estiment parfois qu’il suffit de modifier une phrase musicale, un élément de la chorégraphie ou de la gestuelle pour « désacraliser » une danse. Attitude nullement hypocrite, tempérée par le fait qu’en toute occasion, enfin, les artistes préfèrent conserver l’enracinement sacré des danses qu’ils exécutent et bénéficier du taksu, l’inspiration divine. Même dans les spectacles les plus touristiques et les plus galvaudés, certaines transes ne sont pas feintes.
C’est par ces petits dérapages que les dieux récupèrent ce que les hommes ont cru pouvoir leur retirer.
Jérôme Samuel
Pour aller plus loin, on consultera :
* Cahiers de musiques traditionnelles, n°9, « Nouveaux enjeux », Genève : Ateliers d’Ethnomusicologie, 1996.
* Erguner (Kudsi), La Fontaine de la séparation. Voyage d’un musicien soufi, s.l. : Le Bois d’Orion, 2000.
* Internationale de l’Imaginaire, nouvelle série n°4, « La musique et le monde », Paris : Babel, 1995.
* Internationale de l’Imaginaire, nouvelle série n°11, « Les musiques du monde en question », Paris : Babel, 1999.
* Picard (M,), Bali. Tourisme culturel et culture touristique, Paris : L’Harmattan, 1992.