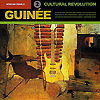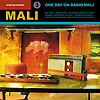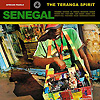<i>Perles d’Afrique</i>

Ils sont sénégalais, congolais, maliens, guinéens. Leurs noms sont souvent évoqués car ils font aujourd’hui figure de références, mais qui a vraiment entendu ce qu’ils jouaient à l’époque ? C’est cette lacune que se propose de combler la collection Perles d’Afrique, tout au moins pour une partie de l’Afrique subsaharienne francophone.
Une collection entre musique(s) et histoire(s)
Ils sont sénégalais, congolais, maliens, guinéens. Leurs noms sont souvent évoqués car ils font aujourd’hui figure de références, mais qui a vraiment entendu ce qu’ils jouaient à l’époque ? C’est cette lacune que se propose de combler la collection Perles d’Afrique, tout au moins pour une partie de l’Afrique subsaharienne francophone.
Quatre volumes, soit huit CD, un casting quasi encyclopédique complété par des notes explicatives particulièrement riches : il n’en faut guère plus pour révéler les bases sur lesquelles quelques musiques phares du continent africain se sont construites depuis un demi-siècle. Consacré à la Guinée, Cultural Revolution rappelle le rôle moteur joué alors par ce petit pays au lendemain des indépendances, sous l’impulsion de son chef d’Etat Sékou Touré et au nom de l’authenticité. Derrière les emblématiques Ballets africains de Keita Fodeba, enregistrés ici en 1957 avec Sory Kandia Kouyaté (lequel reçut le Grand Prix du disque de l’académie Charles Cros en 1970), de nombreux orchestres nationalisés sont apparus sur tout le territoire : le Horoya Band, Balla et ses Balladins et bien sûr le Bembeya Jazz National, avec son guitariste Sékou Diabaté. Ce bouillonnement musical attira aussi la Sud-Africaine Miriam Makeba qui s’établit à Conakry en 1968 pour y poursuivre sa carrière, après avoir fui les Etats-Unis.
Suivant l’exemple de son voisin, le Mali s’est également efforcé de mener une politique culturelle très active. One Day on Radio Mali réunit la musique traditionnelle, telle que la jouaient dans les années 1960 Sidiki Diabaté et Djelimady Sissoko ou encore Sékou Kouyaté sur sa version de Kaïra, et celle plus moderne des formations comme le Rail Band ou les Ambassadeurs du Motel, dont les chansons sélectionnées datent toutes deux de 1977.
Si Bamako passe de nos jours pour l’une des capitales de la musique africaine, Kinshasa et Brazzaville ont longtemps occupé ce rang, ainsi que le souligne Rumba on the River. La rumba congolaise est probablement le genre qui s’est le plus répandu sur le continent, dès la fin des années 1950. La quasi totalité des titres choisis ici sont antérieurs à 1970, avec des incontournables : Independance Cha Cha et Table Ronde, écrits en une nuit à Bruxelles, lors des négociations menées avec la Belgique pour l’indépendance. Aucune des vedettes de cet âge d’or de la rumba n’est oubliée : Franco, Docteur Nico, Tabu Ley Rochereau et Joseph Kabasele, surnommé le “Grand Kallé”, qui a su convaincre le jeune Manu Dibango de le suivre dans la capitale zaïroise.
Enfin, dernier volet commercialisé de cette série, Teranga Spirit revient sur l’évolution de la musique sénégalaise au cours des années 1960 et 1970. Au cours de ces décennies, certaines formations, à l’image de Xalam et Ifang Bongi (ex-Super Eagles de Banjul), se sont réapproprié les instruments et les rythmes traditionnels qui n’avaient pas leur place dans le son afro-cubain très en vogue, porté entre autres, par Orchestra Baobab et le Star Band de Dakar, groupe au sein duquel chantait Pape Seck, qui mettra dans les années 1990 sa voix au service de l’afro-salsa d’Africando. Raconter une histoire, riche, parfois complexe mais passionnante, en s’appuyant sur des chansons, voilà ce qui fait le charme de chacun des volumes de la collection Perles d’Afrique, formidable outil pour connaitre les fondamentaux de ces musiques africaines.
Perles d’Afrique : Cultural Revolution (2CD) – Rumba on the River (2CD – One Day on Radio Mali (2CD) – Teranga Spirit (2CD) (Syllart/Discograph) 2006