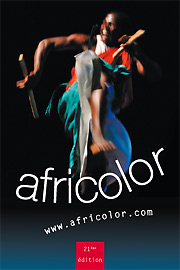20 bougies pour Africolor

Né il y a vingt ans par une Nuit de Noël, sur le territoire métissé de Seine-Saint-Denis, le festival Africolor a suivi l’évolution des musiques africaines en France. Malgré quelques embûches, la manifestation, à mi-édition en ce début décembre 2009, continue à porter haut les couleurs de ses exigences artistiques.
L’histoire commence une Nuit de Noël, il y a de cela vingt ans. Un journaliste, parmi les fondateurs de Libération, plume émérite et pionnière des musiques du monde, auteur d’ouvrages sur Kassav’ et Johnny Clegg, décide de lancer un festival original : une manifestation aux oreilles tournées vers l’Afrique, sensible à la palette musicale de ce vaste continent. Pour cet activiste de gauche que reste Philippe Conrath, le choix du réveillon pour sa première constitue en outre une aubaine, soit l’occasion d’échapper aux routines festives. Dans la salle du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, qui coproduit l’événement, un miracle survient : attirés par le chant divin de Nawa Doumbia, quelques cinq cents Maliens envahissent le lieu. Dès l’édition originelle, le programmateur saisit la force et l’enjeu d’un territoire qui rattrape ses ambitions. Il n’aura, dès lors, de cesse de travailler ce public communautaire et de le confronter à celui d’origine « française ». Pendant près de dix ans, le succès de ces Nuits de Noël ne se dément pas, jusqu’à atteindre, en 1998, deux mille personnes avides de musique, restées aux portes d’un lieu de sept cents places. Victime de son succès et suite à un changement d’orientation du théâtre, le festival adopte en 2001 sa formule définitive : financée en majeure partie par le département, la manifestation abandonne la Nuit de Noël et devient itinérante, pour se déployer sur dix-huit villes de Seine-Saint-Denis en vingt-cinq concerts, riches de thématiques fortes.
Evolution
Durant vingt ans ans, le festival Africolor a ainsi su refléter les évolutions de la musique africaine – et plus largement de la musique du monde – en France. Lors de sa naissance, il surfe sur la vague d’un genre branché. En cette fin d’années 1980, le Top 50 diffuse en boucle Yeke Yeke de Mory Kante, le magazine Glamour consacre une double-page aux musiciens africains de Paris, quand Elle se gargarise du mariage de Johnny Clegg… Les idoles du moment se nomment Alpha Blondy ou Kassav’. Un courant qui pourtant "binairise" les originaux, à coup de boum-boums, pour les rendre audibles aux feuilles occidentales. Si aujourd’hui, le vent des modes délaisse ces musiques, leurs sons complexes ont en revanche réussi à infiltrer le rock, l’électro, le jazz. Aujourd’hui, la polyrythmie et les gammes pentatoniques n’effraient plus. Les musiciens occidentaux s’y intéressent, peuvent même acquérir leurs techniques dans les conservatoires. "Avec ces musiques-là, nous sommes passés d’une curiosité exotique, à une attitude néo-colonialiste, jusqu’à l’élaboration d’un véritable dialogue", souligne Philippe Conrath, assurément l’un des artisans de ce progrès.
Une connivence musicale immédiate, qui témoigne de l’évolution de la société civile, à rebours d’une politique de repli identitaire, comme le remarque amèrement ce programmateur, créateur de connexions. Titi Robin avec Danyel Waro, le Trio Chemirani avec les balafons de Néba Solo… : Africolor a su, au fil de son histoire, répondre aux envies d’artistes désireux de se frotter à d’autres univers. L’édition 2009 ne déroge d’ailleurs pas à la règle, avec des créations qui unissent l’ensemble baroque XVIII-21 et l’Ethiopienne Minyeshu (le 15 décembre, au Blanc-Mesnil), ou encore la formation de musique contemporaine Quatuor Béla avec le griot malien Moriba Koïta (le 20 décembre, en clôture de festival, à Bobigny)
Aléas
Dans cette épopée, la plus grande fierté de Philippe Conrath reste d’avoir su fidéliser les artistes, d’avoir cristallisé des amitiés fortes, comme celles avec Danyel Waro, chantre du maloya, qu’il a produit sur le label d’Africolor, Cobalt. Mais le chemin demeure semé d’embûches, avec le problème récurrent des visas d’artistes, et la réduction budgétaire. Cette année, le festival a ainsi perdu 30000 euros, après un retrait de subventions du ministère des Affaires étrangères, et du Centre National des Variétés. Mais plus que tout, Philippe Conrath redoute aujourd’hui les réformes territoriales qui risqueraient de réduire, voire anéantir les financements alloués par les départements. Des difficultés palpables qui ne sauraient, pour autant, ternir l’exigence artistique. Cette année encore, Africolor livre une édition de haut vol. Un festival qui, au-delà des sons, milite, s’engage, résiste.
Africolor, jusqu’au 20 décembre 2009