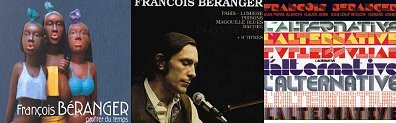François Béranger 1937-2003

Incarnation exemplaire de la figure du chanteur engagé des années 70, François Béranger est mort hier à l’âge de soixante-six ans. Retour sur une longue carrière.
Le Bruant des seventies.
Incarnation exemplaire de la figure du chanteur engagé des années 70, François Béranger est mort hier à l’âge de soixante-six ans. Retour sur une longue carrière.
"Mamadou m'a dit/Mamadou m'a dit/On a pressé le citron/On peut jeter la peau" Cette chanson, Mamadou m’a dit, était le seul vrai "tube" de François Béranger et beaucoup de radios françaises l’ont diffusé hier pour annoncer la mort du chanteur, des suites d’un cancer qui l’a emporté à 66 ans. Mais le doux refrain chaloupé qui avait ensoleillé les ondes en 1979 avait peut-être occulté la violence des couplets: "Les citrons c'est les négros/Tous les négros d'Afrique (...) Les colons sont partis avec des flons-flons/Des discours solennels des bénédictions/Chaque peuple c'est normal dispose de lui-même/Et doit s'épanouir dans l'harmonie/Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines/Qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris".
C’était cela, la voix de François Béranger, une voix virulente qui aimait à porter le fer dans la plaie, une voix perpétuellement indignée, révoltée, écoeurée par les injustices du monde et le sort fait aux exclus. Certainement le parangon du chanteur engagé comme les années 60-70 les virent éclore.
Son terreau, ce fut la classe ouvrière, la banlieue, les destinées brisées dès l’enfance des damnés de la terre, cette idée que, comme le chante L’Internationale qu’il enregistrera un siècle après qu’elle eut été écrite, "Nul devoir ne s'impose au riche/Le droit du pauvre est un mot creux". Né en 1937, il passe son enfance à Suresnes, fils d’un ouvrier chez Renault-Billancourt et d’une couturière à domicile payée à la pièce. Son père, André Béranger, est un syndicaliste, un bon orateur, un résistant pendant la guerre. Il sera même député de la Nièvre de 1945 à 1951. Mais ce n’est pas la révolte rouge, chez les Béranger: papa est MRP, ce que l’on appelle alors un "chrétien social". Il croit en l’éducation, en l’ascension individuelle. Le jeune François est envoyé sur la voie des études mais, à quinze ans, choisit quand même d’entrer chez Renault. Le rêve prolétarien s’évanouit rapidement: "L’usine c’est bien joli, mais ça abrutit vite", dira-t-il plus tard. Il se rêve alors en comédien, rejoint La Roulotte, une de ces troupes mi-amateurs mi-saltimbanques qui courent les routes de France dans ces années 50 beaucoup plus turbulentes qu’on ne l’imagine: théâtre, mime, folklore, danse, mais aussi chanson, pour un Béranger qui vient de découvrir Félix Leclerc et Stéphane Golmann. La Roulotte joue dans les hôpitaux, les prisons, les chantiers, les quartiers défavorisés...
1959: Béranger part pour l’Algérie, qui a basculé dans la tenace horreur de l’interminable "opération de maintien de l’ordre" - c’est ainsi que la guerre s’appelle officiellement. Il trompe l’ennui, le cafard, la peur et le dégoût dans une consommation effrénée de livre. Lorsqu’il revient en métropole, dix-neuf mois plus tard, il retourne chez Renault, où il ne trouve pas plus sa place que quelques années plus tôt. Par hasard, il entre à l’ORTF, où il devient chargé de production à la télévision, où son non-conformisme le fait rapidement mettre sur la touche. C’est là que Mai-68 va le saisir. Il a dépassé trente ans et se paye moins de mots que ses cadets enflammés de la cour de la Sorbonne. Mais quelque chose dans l’air réveille en lui le petit diablotin de la chanson, endormi depuis dix ans.
En même temps qu’il dirige une société de relations publiques, il enregistre artisanalement une douzaine de chansons qui circulent entre amis. Ses chansons arrivent un jour chez CBS, une des plus grosses maisons de disques en France: on lui signe un contrat de cinq ans. Le premier 45-tours sera Tranche de vie, chanson qui s’étale sur les deux faces et raconte à la première personne la vie d’un exclu mi-révolté, mi-victime de la société. Le ton est dans la droite ligne des chansons d’Aristide Bruant ou de Gaston Couté, âcre et tranchant: "Les flics m’ont vachement/Faut dire qu’j’m’étais amusé/A leur balancer des pavés (...) Les flics pour c’qui est d’la monnaie/Ils la rendent avec intérêts/Le crâne, le ventre et les roustons/Enfin quoi vive la nation".
Succès immédiat. Ce n’est pas la radio (à l’époque intégralement contrôlée, directement ou indirectement, par l’Etat) qui passe ses chansons, mais elles circulent abondamment, en disques ou par ces minicassettes qui permettent depuis peu de recopier la musique à bon marché. Les relations avec CBS sont rapidement tendues: au moment où il prépare son deuxième album en 1971, une chanson est retirée sur ordre de la direction. Pour se venger, il couvre les murs des toilettes de sa maison de disques d’autocollants de La Cause du peuple, organe maoïste interdit. Séparé "à l’amiable" de CBS, il signe avec L’Escargot-Sibecar, un de ces premiers "indés" du disque - et du disque engagé. Il y restera dix ans, le temps d’enregistrer huit albums. Il frappe à bras raccourcis sur le capital, la police, l’armée, les pollueurs, les colonialistes, les racistes... Ses chansons épousent, précèdent ou accompagnent toutes les grandes luttes radicales de la gauche et de l’extrême gauche françaises. Raymond Marcelin, le ministre de l’Intérieur, qualifie d’une formule lapidaire tous ces trublions, des nouveaux syndicalistes radicaux aux babas cool qui partent élever des chèvres dans les Causses, des féministes qui brûlent leur soutien-gorge aux "contestataires" étudiants: "ennemis intérieurs". Béranger devient la voix des ennemis intérieurs...
Une voix gouailleuse, un accent de banlieue prolétaire, une manière de mêler l’argot et la versification classique, qui seront d’une influence décisive sur ses cadets, de Renaud à François Hadji-Lazaro. Aux influences folk des premiers disques, il étend ses recherches musicales à un très large spectre de musiques populaires, d’un rock quasi-expérimental au tango, en passant par diverses musiques du monde, la fanfare, le dépouillement extrême ou les prémices de la musique électronique...
Mais, dès le 10 mai 1981, il subit le contre-coup paradoxal de l’arrivée au pouvoir de la gauche. Il a tant chanté le changement à venir qu’en 1982 il chante cette question: "Le vrai changement c’est quand ?" Et il raccroche. Jusqu’en 1989, il se retire des studios et des scènes, après avoir écumé toutes les salles et festivals possibles pendant une dizaine d’années.
Il se passionne pour l’aviation et le pilotage, construit sa maison tout entière de ses propres mains, s’accorde quelques retours de loin en loin, quand "l’urgence" de chanter se fait trop forte - trois disques épars en 1989, 1992, 1997, quelques concerts parisiens en 1999 et 2002... Mais Béranger apparaît d’autant plus comme un survivant d’une époque répudiée par le show business contemporain qu’il ne baisse jamais la garde, dans ses chansons comme dans ses interviews: imprécateur tenace, il ne cesse de dénoncer "le monde immonde", la violence sociale du capitalisme et les insuffisances de la gauche de gouvernement... Pourtant, il laisse dans la culture populaire française une trace profonde, qui est l’affirmation têtue que la chanson peut se refuser à tout compromis, à toute politesse, à toute tiédeur. Cette posture de misanthrope et d’humaniste à la fois ne pouvait que se trouver des héritiers, parfois inattendus. Ainsi, Sanseverino, un des plus talentueux chanteurs apparus ces dernières années lui avait ainsi dédié sa Victoire de la musique 2003 (révélation de l’année), après avoir repris son acide Tango de l’ennui.