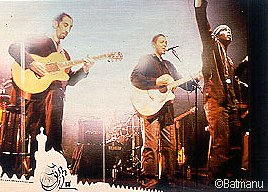SALAM ALEÏKOUM, JEUNESSE

Paris, le 26 juin 2001 - Samedi 23 juin dernier, le parc ensoleillé du domaine Chérioux à Vitry-sur-seine en banlieue parisienne a vibré sous les doux (et percutants) assauts des rythmes et des sonorités de la création musicale algéro-française, mise à l’honneur dans le cadre de la soirée des « Musiques du monde » de l’édition 2001 du Festival de la jeunesse.
Soirée arabe au Festival de la jeunesse
Paris, le 26 juin 2001 - Samedi 23 juin dernier, le parc ensoleillé du domaine Chérioux à Vitry-sur-seine en banlieue parisienne a vibré sous les doux (et percutants) assauts des rythmes et des sonorités de la création musicale algéro-française, mise à l’honneur dans le cadre de la soirée des « Musiques du monde » de l’édition 2001 du Festival de la jeunesse.
Jeunesses du monde
Créé en 1989, le Festival de la jeunesse a choisi de travailler cette année sur le thème des « jeunesses du monde ». «Cette réorientation est née du souci de se tenir au plus près des pratiques artistiques et culturelles des jeunes, et pourrait bien annoncer la tournure du festival dans les années à venir», souligne Didier Guillaume, directeur du festival pour la sixième année consécutive. «Nous avons souhaité que la thématique des jeunesses du monde soit la plus présente possible sur chacune des trois dates de notre programmation, la nuit des musiques électroniques, la journée hip hop et la soirée des musiques du monde. Contre l’intolérance, la violence et le racisme, nous nous sommes tenus à l’axe du pluri-ethnique, pour créer un évènement festif fait de rencontres entre les traditions et les racines des jeunes franciliens, dans leur diversité.» Au programme le 23 juin, Gnawa Diffusion,Tafkarinas et Zenzila, représentatifs de ce courant qui renouvelle la création musicale hexagonale en puisant dans les traditions musicales du Maghreb. (Et aussi, le Colombien Yuri Buenaventura et l’ensemble Paris Salsa All Stars).
Solidarités
À 16h, les portes se sont ouvertes sur une immense esplanade verdoyante. D’un côté, la scène. De l’autre, à l’ombre de quelques grands arbres, les stands des partenaires associatifs «qui œuvrent dans le domaine de la solidarité» Amnesty International, Aide et Action qui favorise la scolarisation, le Collectif des Sans-Papiers du Val de Marne. Didier Guillaume souligne : «Ça me semble important que ces partenaires associatifs soient là pour développer et faire découvrir leur action et sensibiliser le public, même si c’est ponctuellement, à la difficulté des femmes afghanes aujourd’hui, aux évènements qui se passent en Algérie, grâce à la présence d’associations berbères (le collectif Enfants-Algérie), à l’importance de soutenir les exploitants agricoles, grâce au commerce équitable, avec Artisans du monde ou le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, à l’importance de soutenir le rôle des femmes en Afrique, à travers l’Union des Femmes Africaines en France.»
L’identité ne coule pas dans les veines
À 17h, les Gnawa Diffusion entrent en scène. Formés en 1992, à Grenoble, par des Algériens et des Français autour d’Amazigh Kateb, fils de l’écrivain algérien Kateb Yacine, les Gnawa ont emprunté leur nom à ce peuple du Soudan déporté en Afrique du Nord au XVIème siècle pour y être réduits en esclavage. Ils chantent en arabe, en français et en anglais et les basses, guitares électriques et batteries côtoient les instruments anciens d’origine africaine, les harmonies, les mélodies arabes et les castagnettes en fer qui scandent traditionnellement les rythmes des danses gnawa. «Vous voulez chanter, là ? Parce que normalement c’est l’heure du café au lait, mais on va essayer de chanter quand même» lance Amazigh à la foule des spectateurs, debout ou allongés sur l’immense pelouse. La musique des Gnawa, terriblement festive, scénique par excellence, touche depuis longtemps un public diversifié, ce que le groupe souhaitait. Ils se produisent dans des festivals reggae, des festivals world, ou chez les arabes, dans l’intercommunautaire, ce qui, au total, est une façon de déjouer les processus d’étiquetage. Les Gnawa ne font pas l’apologie du retour aux racines et ne cherchent pas à susciter une quelconque fièvre identitaire chez les jeunes d’origine maghrébine. «Beur, c’est une étiquette pour expulser de l’intérieur », a dit un jour Amazigh, pointant l’absurdité et les dangers de cette "labellisation" de jeunes Français de la deuxième, troisième ou quatrième génération (!). Le message est clair : l’identité n’est pas génétique et «il faut arrêter de leur faire croire que leur identité, elle coule dans leurs veines». Cette position, très ferme chez les Gnawa, semble exclure le genre d’interpellations lancées par Zenzila...
«Si tu ne sais pas où tu vas, rappelles-toi d’où tu viens.»
C’est le refrain d’un nouveau titre de Zenzila, qui chante en arabe et en français, et semble s’inscrire dans la filiation de Zebda, dans ce courant du rock français qui se cherche au travers du rock oriental. «Tu te prends pour un autre depuis que tu t’es décoloré / mais sous la couleur c’est Méditerranée... On voudrait éviter ce que l’on est / on est rattrapé par ce que l’on fait... Si tu ne sais pas où tu vas, rappelles-toi d’où tu viens/ si tu ne sais pas où tu vas, je te donnerai la main». Le public reprend en chœur, avant d’entonner une mélopée hypnotique qui dit «salam aleïkoum», comme il en a chanté avec les Gnawa. Zenzila incarne un autre courant, qui professe qu’«une plante, sans ses racines elle meurt». D’autres diraient qu’un être humain ce n’est pas une plante : il n’a pas de racines, il a des pieds. Et les pieds, ça permet de se déplacer...
«J’ai fait un pari avec Rachid, il m’a dit : ils ne vont pas faire l’affaire»…
…lance Tafkarinas, chanteur kabyle qui innove dans la tradition de la Yal music, en référence au chant entonné en Kabylie depuis la nuit des temps. Entre autres collaborations, Tafkarinas a enregistré un duo avec le rappeur Farid Gaya, et c’était une première d’entendre du rap chanté en berbère... L’enjeu du pari, cette après-midi du 23, consistait à faire chanter en kabyle le public mixte du festival. «Je dédie cette chanson à la Kabylie et à l’abolition des frontières». Pari tenu, le public a chanté en kabyle. Il a fait l’affaire.
Cécile Sanchez