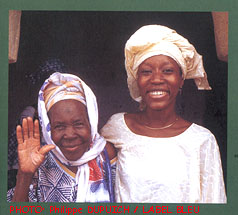Rokia Traore : Une Découverte qui s'affirme

Lauréate du concours Découvertes Afrique 1997, la chanteuse malienne Rokia Traore n'a que vingt-six ans mais possède déjà l'aisance des grands. Elle sort son deuxième album, Wanita, d'une séduction idéale, et confirme que derrière les stars, au Mali, une nouvelle génération d'artistes prend ses marques pour le futur.
Un album entre douceur et groove
Lauréate du concours Découvertes Afrique 1997, la chanteuse malienne Rokia Traore n'a que vingt-six ans mais possède déjà l'aisance des grands. Elle sort son deuxième album, Wanita, d'une séduction idéale, et confirme que derrière les stars, au Mali, une nouvelle génération d'artistes prend ses marques pour le futur.
«Petit à petit l'oiseau fait son nid» dit le proverbe. Ainsi va Rokia Traoré.
Sans tapage, ni effets médiatiques outranciers, lentement, sa notoriété grandit. L'affluence que connaissent ses concerts (on l'a vu notamment au Café de la Danse à Paris, récemment), les chiffres de vente de son premier album (plus de 20.000 exemplaires écoulés en France), sorti en 1998, l'attestent sans ambiguïté. Lorsqu'elle se présente la première fois au festival «Musiques Métisses» à Angoulême, en 1997, elle n'a que 23 ans.
Inconnue alors du public français, chez elle, au Mali, elle a déjà fait mouche sur quelques «grands-frères». Ali Farka Touré par exemple, qui ne cesse de clamer autour de lui tout le bien qu'il pense de cette menue chanteuse. Elle profite de son passage en France pour enregistrer son premier album, Mouneïssa. La même année, elle reçoit le Prix Découverte RFI Afrique. Cette récompense lui ouvre les portes du Bouillon de Culture «spécial Mali» enregistré par Bernard Pivot à Bamako.
Bamako, elle y est née. Elle en est partie parfois, y est revenue, au gré des déplacements de son père diplomate, aujourd'hui en retraite. Elle garde au fond d'elle les souvenirs de cette errance. Certains quartiers de Bruxelles lui sont encore étrangement familiers aujourd'hui, elle se souvient aussi des marguerites sauvages qui poussaient partout en Algérie... Quand elle remonte dans son passé, Rokia Traore croise également les images de ses années au lycée à Bamako. Elle s'essayait alors au rap : «J'avais proposé d'intégrer des instruments traditionnels. Mais à l'époque tout le monde trouvait ça ringuard». Elle se dit ravie de voir qu'aujourd'hui des groupes de rap ont adopté cette démarche.
Après quelques années d'études en sciences sociales, elle décide de bifurquer définitivement vers la musique. «Ce choix a été assez violent pour mes parents car ils ne s'y attendaient pas du tout». Papa avait bien eu lui-même quelques vélléités musicales dans le passé, écrit des chansons, joué du saxophone, mais quand on est père au Mali, comme ailleurs, on rêve souvent d'autre chose que de musique pour sa fille. Après un stage d'un mois avec le Koteba d'Abidjan, Rokia Traore se lance. Elle recrute des musiciens utilisant des instruments de la tradition (balaba, ngoni, gaïta, karignan, djembé...).
L'aventure commence. Il est temps pour elle de donner corps et vie aux textes qu'elle écrit en bamanan, de laisser prendre leur envol à ses idées musicales, novatrices mais empreintes de mémoire. Il y aura d'abord Mouneïssa, voici maintenant Wanita. On y retrouve ce qui fait la singularité de Rokia Traore : loin des envolées lyriques qu'affectionnent beaucoup de chanteuses du Mali, avec une retenue extrême, elle égrenne d'une voix fragile des chansons paisibles et cajoleuses. Mais cette fois-ci, elle a voulu davantage jouer du contraste, ouvrir entre les moments rêveurs des espaces agités. Ce parti pris plus dynamique, de chassés-croisés d'atmosphères moins uniformes, vient, explique-t-elle de la diversité des musiques qu'elle a écoutées et découvertes depuis l'enregistrement de Mouneïssa.
Du raga indien par exemple. «J'ai trouvé que la musique traditionnelle de l'Inde et celle du sud du Mali, se ressemblent beaucoup quelque part, dans les tonalités. Alors sur un titre, Souba, j'ai souhaité un peu retrouver le climat de la musique indienne.» Ses oreilles ont aussi croisé des musiques plus nerveuses, celle de Joe Zawinul par exemple. «Je me suis rendue compte que je pouvais aussi apprécier des choses énergiques. C'est comme cela que, naturellement, je suis parvenue à faire des chansons plus dynamiques.» D'où la présence dans Wanita, d'une vigueur nouvelle et de frais tourbillons.
Une énergie dans laquelle la chanteuse rayonne désormais sur scène, se lançant dans des danses sans fin, joyeuses et frénétiques. Elle est loin, très loin la jeune fille timide aux allures de petite fille que le public d'Angoulême découvrait, il y a trois ans à peine.
Patrick Labesse.
Rokia Traoré Wanita (Indigo/label bleu) 2000