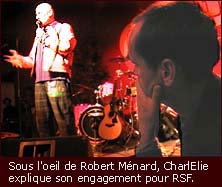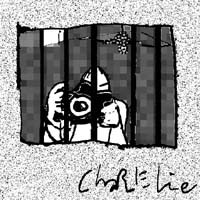UN CD POUR UNE PRESSE LIBRE

Depuis 1985, l'organisation française Reporters sans frontières défend les droits des journalistes à travers le monde. Pour les soutenir, quinze chanteurs et groupes de neuf nationalités chantent la liberté d'expression sur un album, Dignity, qui vient de sortir avec le soutien de Radio France Internationale.
Quinze artistes chantent pour Reporters sans Frontières.
Depuis 1985, l'organisation française Reporters sans frontières défend les droits des journalistes à travers le monde. Pour les soutenir, quinze chanteurs et groupes de neuf nationalités chantent la liberté d'expression sur un album, Dignity, qui vient de sortir avec le soutien de Radio France Internationale.
Une presse bafouée
Ces jours-ci, quand on consulte le site internet de Reporters sans frontières, une toute première page nous accueille par : "Aujourd'hui, 116 journalistes sont emprisonnés". Chine, Cuba, Erythrée, Birmanie, Inde, Iran, Israël, Népal, Turquie, dans tous ces pays, entre autres, des journalistes, reporters, photographes, hommes et femmes de la presse écrite ou audiovisuelle ne peuvent plus exercer leur métier - informer - parce que leur liberté d'expression se heurte à des régimes politiques qui ne souffrent aucune opposition. C'est pour eux que Robert Ménard, lui-même journaliste, a créé Reporters sans frontières en 1985, une organisation non gouvernementale destinée à leur venir en aide, eux et leurs familles, et à interpeller le monde sur leurs conditions de travail bafouées : "Sakharov disait que nommer un homme, c'est le protéger" cite Robert Ménard. "Ce dont ces hommes et ces femmes ont d'abord besoin, c'est qu'on parle d'eux."
Un tel travail nécessite des fonds. Pendant, plusieurs années, RSF a vendu des albums de photos signées par des grands noms tels Robert Doisneau ou Cartier-Bresson. Cette année, ils ont essayé une nouvelle formule qui a fait ses preuves par ailleurs : la musique. "Il s'agit de multiplier les sources de financement" précise Robert Ménard. "Et je vous jure que ça sert ! Ce n'est pas seulement une bonne action. Avec cet argent, on peut sortir des gens de prison, payer leurs avocats et leur nourriture qui est à la charge de leur famille."
Initié par le journaliste Gilles Marquet et mis en œuvre par Yves Bigot, directeur des jeux, des variétés et du divertissement sur la chaîne de télévision publique France 2, et par Virginie Borgeaud, manager entre autres d'Indochine, ce CD réunit quinze chanteurs du monde entier, telle une Internationale de la liberté d'expression. Parmi eux, l'Américain Elliott Murphy, le Congolais Lokua Kanza, le Sénégalais Baaba Maal, le Brésilien Lenine, les Français Jean-Louis Murat, CharlElie ou le groupe Indochine ont écrit spécialement un titre ou enregistré une reprise inédite. Les autres, le Français Jean-Louis Aubert, le Jamaïcain Linton Kwesi Johnson, l'Israélienne Chava Albertstein, les rappeurs Sénégalais de PBS ou l'Algérien Baaziz (qui partage avec certains journalistes de son pays le "privilège" d'être peu apprécié du pouvoir central) offrent un titre déjà enregistré. Tous les droits d'auteurs sont intégralement cédés à RSF, ainsi que les marges commerciales sur les ventes du CD.
Alors que la deuxième Conférence mondiale sur la Musique et la Censure de l'organisation Freemuse* vient de se clore à Copenhague, le combat pour la liberté d'expression semble étrangement commun aux artistes et aux journalistes. C'est l'opinion de Lokua Kanza, chanteur résident en France mais né au cœur d'un pays qui s'appelait alors le Zaïre, où la parole des journalistes n'est pas des plus libres : "Dans mon pays, la République Démocratique du Congo, j'ai connu beaucoup de journalistes qui se sont fait tabasser et qui ont été emprisonnés. La chanson Eteni Na Ngaï parle justement de la non communication et de l'angoisse que ça entraîne. Donc quand on m'a parlé de ce projet, j'ai dit oui tout de suite. Quand on est artiste, on ne peut pas dire qu'on est pas concerné par ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, être artiste, c'est avoir une certaine sensibilité qui permet d'entendre et d'écouter ce qui se passe autour de soi. Et même en tant qu'humain, on a besoin de cette liberté de parole. Comme les journalistes."
Même son de cloche du côté de CharlElie. L'artiste français, citoyen attentif et être humain curieux de sa planète, s'est aussi fendu d'un titre original et explicite, l'Autocensure : "Cette chanson évoque le danger de la précontrainte mentale que l'on appelle l'autocensure qui survient, comme un étau, quand la pensée commune ou imposée par un système en place tend à laisser penser que ceci ou cela ne doit pas être dit et que, par prudence ou par lâcheté, on se soumet à ce diktat. Je n'ai pas l'illusion de croire que ma chanson changera les choses d'une manière directe, mais l'acceptation de participer à ce projet parmi ces autres artistes, signifie que nous sommes solidaires de ce travail de fourmis que fournissent tous ces militants tenaces de RSF qui se battent pour la Liberté d'expression.
Grand voyageur, CharlElie a croisé ici et là des relents de censure : "Avant certains voyages prévus notamment vers l'ex-URSS et au Vietnam, j'ai dû envoyer les textes des chansons que je chanterais là-bas. Cela n'a pas eu d'effet particulier au Vietnam mais par contre, à la suite de cet envoi de textes, le voyage en ex-URSS a été annulé. En Indonésie, lors de mes conférences de presse, j'ai été souvent surpris du condensé que faisait la traductrice officielle, notamment sur certains sujets. Mes longues phrases, résumées à quelques mots, ça me paraissait bizarre... Mais peut-être ne "comprenait-elle" pas bien ce que je voulais dire?…" Définitivement, cette surveillance de la moindre parole "subversive" de l'artiste, par essence libre, est en tous points commune avec ce que vivent certains journalistes : "Comme les artistes, résume CharlElie, les journalistes sont des gens de l'expression, ils font apparaître comme évidentes des choses que l'on ne verrait pas sans eux. Ils sont des révélateurs, quand on supprime le révélateur, la photo n'apparaît pas. Et si l'on ne voit plus d'image, on devient aveugle."
Le mot de la fin revient à Robert Ménard : "Pas de liberté sans liberté de la presse et ce n'est pas un slogan !"