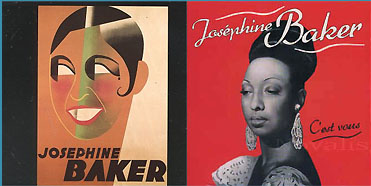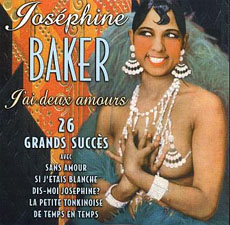LA SAGA JOSEPHINE BAKER

Paris, le 8 avril 2002 - En 1975, s'éteignait sur la scène de Bobino la flamme allumée au début du siècle par une petite danseuse américaine délurée, devenue meneuse de revue à succès sur le Vieux continent. Femme de conviction, consacrée dès la Deuxième Guerre mondiale, elle canalisa surtout les envies d'exotisme de Paris, capitale autoproclamée, déjà, des cultures du monde. Un livre de l'Irlandais Ean Wood lui rend hommage.
La reine des années folles
Paris, le 8 avril 2002 - En 1975, s'éteignait sur la scène de Bobino la flamme allumée au début du siècle par une petite danseuse américaine délurée, devenue meneuse de revue à succès sur le Vieux continent. Femme de conviction, consacrée dès la Deuxième Guerre mondiale, elle canalisa surtout les envies d'exotisme de Paris, capitale autoproclamée, déjà, des cultures du monde. Un livre de l'Irlandais Ean Wood lui rend hommage.
Le titre de l'ouvrage est un programme à lui seul : La folie Joséphine Baker. Sorti aux éditions du Serpent à Plumes, après être paru en terre anglaise, cette biographie se veut fidèle au personnage. Ean Wood raconte la fabuleuse épopée d'une femme, qui, à force de "danser tout le temps pour se réchauffer", a fini sa vie sous les projecteurs et les ovations multiples. Il faut avoir vécu en 1925 pour arriver à imaginer le fantasme que peut incarner la petite môme du Missouri sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Rolf de Maré, mécène et fondateur des fameux Ballets suédois, vient d'y lancer La Revue Nègre de Caroline Dudley. Joséphine par son audace et ses tenues légères en fait un succès, qui s'inscrit en lettres d'or dans la légende du music-hall. Prisé à l'époque, le genre marque, et la nuit parisienne et l'histoire d'une France terre d'accueil des cultures du monde.
Phénoménale
"Paris n'avait jamais rien vu de tel. Elle se tapait les fesses en rythme, virevoltait comme une toupie, se pliait et se tordait dans tous les sens, au gré d'une suite de pas extraits de son répertoire.(…)Les journalistes qui la décrivirent durent avoir recours au lexique animal : elle était kangourou, serpent, girafe, panthère, singe, oiseaux des îles" écrit Wood, en parlant de sa première apparition sur la scène française. Joséphine ne chante pas encore. Elle est là pour son génie de la danse. Son répertoire de pas était infini. C'est elle qui lance le Charleston en Europe. Elle improvise en la matière comme personne. Et pour pimenter les numéros, on la fait apparaître, souvent habillée au strict minimum, fesses à l'air. Elle scandalise et nourrit le bouche-à-oreille du Tout-Paris, qui se précipite alors pour la voir. Créature sauvage, bête surprise, danse primitive… les vocables utilisés embrassent l'époque. L'exposition coloniale, où l'on fait défiler le Noir inférieur et soumis n'est pas loin. Attraction osée, noire Joséphine devient "une nouvelle incarnation de l'exotisme". Avec plus de chic. On parle aussi du "noble sauvage". L'un de ses amants, l'écrivain Georges Simenon, signalera un jour "sa croupe qui rit" dans un article du journal Le Merle Rose.
Elle enflamme les esprits. On la voit partout. Au théâtre, dans les boîtes de nuit ou les réceptions mondaines. Nombre de célébrités du monde artistiques, poètes, écrivains, artistes, s'affichent à ses côtés. Pour eux, elle est le symbole d'une certaine modernité. Elle accompagne du coup l'engouement récent des créateurs européens pour les arts nègres. Matisse, Modigliani, Dali ou Picasso se passionnent pour les objets venant du monde noir. Les dadaïstes organisent des soirées africaines, inspirées des masques rituels. Et André Daven, le patron du Théâtre des Champs-Élysées, où l'on voit Joséphine pour la première fois, s'entend avec le cubiste Fernand Léger. C'est lui qui lui conseille d'aller chercher les Noirs Américains pour renouveler son répertoire, afin de séduire à nouveau le public : "Donnez-leur des nègres. Il n'y a que ça pour exciter Paris" lui avait-il dit. C'est ainsi que démarre l'aventure de la Baker dans un pays, où elle se sent nettement mieux que dans le sien, à cause du racisme brut des Etats-Unis. En tous les cas, elle marque de son pas, ensuite de son chant la période des années folles. Elle en devient la reine. Même si, comme le relate Paul Colin dans ses souvenirs, elle est vêtue à ses débuts "en guenilles" et "tenait de la femme caoutchouc et de la femelle de Tarzan". Colin crée les décors et l'affiche de La Revue Nègre. Il y gagne en célébrité et est aussi l'un de ses amours.
Le racisme au cœur de son histoire
La folie Joséphine ne s'arrêtera plus jamais dès lors. Issue d'un milieu pauvre, elle a toujours rêvé de côtoyer les plus grands. Paris lui en donne les moyens. Née en 1906 à Saint-Louis du Missouri, Freda Mc Donald, de son vrai nom, assiste très jeune à une descente punitive de Blancs dans les quartiers noirs de la ville. Ils tuent et incendient à tour de bras. Elle a alors onze ans et ne désire qu'une seule chose : partir et quitter ce monde de terreur et de misère. Elle quitte sa famille pour courir les routes avec une troupe d'artistes itinérants, apprend la musique, le chant, les pas de danses les plus compliqués et s'invente un style de plus en plus apprécié. A treize ans, elle est une vraie professionnelle du music-hall. Elle commence surtout à sauter sur les opportunités offertes, avec une chance inouïe et un talent toujours irréprochable. Mariée à treize ans, remariée à quatorze, elle se bat toute sa vie pour être à l'abri du besoin. Esprit vif et avisé, elle y parvient, non sans mal. Philadelphie, Broadway, Paris, Berlin, Rio de Janeiro, le monde entier se laisse envoûter par sa grâce et lui ouvre ses portes. Réduire son succès à la guirlande de bananes de ses débuts autour de sa taille, comme l'ont fait certains, est ainsi devenue inconcevable.
En France, elle écume les clubs, joue au cinéma et surtout chante avec bonheur ses "deux amours, mon pays et Paris", titre que lui écrit Vincent Scotto en 1931. Les Folies-Bergère, le Casino de Paris, Bobino et bien d'autres salles encore viennent nourrir sa légende. En 1935, un retour aux Etats-Unis lui rappelle son dur passé. Des tas de lieux sont encore "interdits aux Noirs et aux chiens". Des hôtels lui ferment leurs portes. A Paris, le luxe lui évite le racisme ordinaire. Aux Etats-Unis, elle le retrouve de façon brutale. La communauté noire lui reproche par ailleurs de donner une piètre image de ses "frères et sœurs de race".
L'engagement
A son retour en Europe, elle s'interroge sur ce qu'elle est devenue mais ne renie aucune des expériences passées. Elle s'engage alors pour les plus défavorisés. Lors de la seconde Guerre mondiale, Mistinguett continue à porter haut le flambeau du music-hall, pendant que Joséphine se met au service des forces de la France libre. Agent secret, elle est promue sous-lieutenant et à la fin de la guerre, reçoit la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Elle change alors de registre. Fini "le temps de la Vénus noire à la ceinture de plumes et de bananes, de l'oiseau des îles et de la femme-objet" écrit Jacques Siclier à sa mort dans le journal Le Monde. Dans les revues, elle change de registre, de costume et de chant. Elle devient moins provocante. Mais elle continue néanmoins à rayonner, s'impose dans son pays au débuts des années 50, lutte aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques, adopte douze enfants de toutes les races et fonde un asile de la fraternité humaine en Dordogne.
Femme de conviction mais surtout mais femme de scène, Joséphine Baker meurt le 12 avril 1975 à l'hôpital parisien de la Pitié Salpetrière à soixante-neuf ans. Quatre jours plus tôt, le 8 avril, elle était encore sur la scène de Bobino pour un dernier tour de chant. Elle y interprétait avec une fougue inattendue une revue en hommage à ses cinquante années de carrière. Le Président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, lui adressa un mot à cette occasion : "En rendant hommage à votre talent universel et en vous exprimant la reconnaissance de la France dont le cœur a si souvent battu avec le vôtre". Le magazine L'Express commenta la première en ces termes : "Ce n'est plus un come-back. C'est l'éternel retour". Le lendemain, une hémorragie cérébrale l'emportait dans le coma.
L'imaginaire occidental se souviendra certainement longtemps de la première star noire. Ean Wood, lui, a voulu lui rendre un ultime hommage avec ce livre, où il laisse transparaître un peu de son admiration, tout en mimant les époques et leurs contradictions. Joséphine Baker, conclut-il à la fin de son ouvrage, "a été pour beaucoup un rayon de soleil, une source de joie".
Soeuf Elbadawi
La folie Joséphine Baker de Ean Wood (Le Serpent à Plumes).